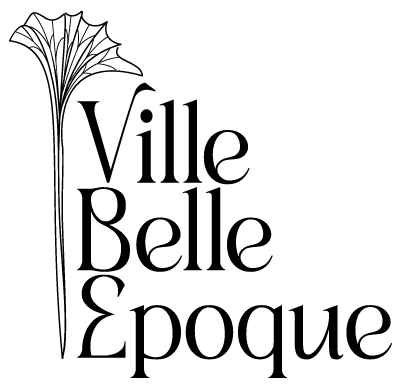Histoire de la Belle Époque
Cette section accueille les inventaires du patrimoine de chaque ville membre du réseau. La Belle Époque a participé à révéler une grande variété de typologies de patrimoines (bâtis, naturels, culturels, industriels ou encore immatériels) qui reflètent l’esthétique, la créativité et l’innovation de cette période faste de l’histoire française et européenne.
L'architecture résidentielle

Attelages longeant les côtes rocailleuses, crieurs de journaux, tohu-bohu du tramway, groupes d’amis rassemblés en terrasse pour profiter des derniers rayons du soleil en savourant un verre d’absinthe… Toutes ces images reflètent l’esprit de la « Belle Epoque », cette ère paisible qui a précédé la Première Guerre Mondiale.
Avec ce souffle d’insouciance s’est popularisée la mode des bains de mer et des cures thermales, arrivée d’Outre-Manche, qui éleva progressivement de nombreux petits villages de pêcheurs et d’agriculteurs au rang de stations balnéaires ou thermales. Ce fut tout particulièrement le cas sur la Côte Fleurie, le littoral normand courant de Trouville à Honfleur, ainsi que sur la Côte d’Azur. Dès le milieu du XIXème siècle, elles développèrent une offre de loisirs centrée sur cette nouvelle économie touristique.
L’émergence de ces nouvelles infrastructures culturelles et sportives, ainsi que l’arrivée du chemin de fer, entrainèrent l’édification sur toute la côte normande ainsi que sur le littoral méditerranéen de centaines d’imposantes maisons de villégiature destinées à servir de résidences secondaires aux notables des environs, dont nombre sont encore intactes à ce jour.
Ces manoirs, villas, cottages ou encore hôtels particuliers à l’allure éclectique, empruntent alors librement aux grands courants architecturaux des éléments parfois gothiques, parfois renaissants et parfois classiques. Ces demeures sont notamment reconnaissables à l’importance accordée aux volumes de leurs toitures, qui souvent débordent des façades pour mieux les protéger des intempéries, ainsi qu’à leurs larges balcons, conçus pour profiter du soleil. Des matériaux inhabituels tels que la brique vernissée ou émaillée, le bois, les épis de faîtage ou encore les garde-corps des balcons y ont aussi la part belle.
Les villes de l’association « Ville Belle Époque » ont toutes été des lieux d’expérimentation privilégiés de cette architecture nouvelle et composite, dont subsistent encore aujourd’hui de nombreux témoins, telle que les magnifiques villas qui bordent la promenade Roland Garros à Houlgate. On peut par exemple citer Les Embruns, datant de 1889, les villas jumelles Les Courlis et Les Sirènes, construites en 1890, ou bien, juste derrière, Les Luciole, où habitèrent notamment les frères Lumière.
La ville de Saint-Raphaël n’est pas en reste, avec notamment sa villa Les Palmiers, une des premières demeures de caractère à avoir été élevée dans la station balnéaire naissante, ou encore son Hôtel de la Plage et de la Méditerranée, construit en 1914.
La Villa Millet, à Cabourg, brille par son éclectisme : construite en 1883, elle a été conçue comme un petit château, et à la particularité d’avoir deux façades très différentes, avec un style Louis XIII d’un côté et une façade au style plus italien côté mer.
Enfin, comment ne pas mentionner la Villa Emma de Spa, édifiée en 1855, qui se distingue par son riche décor Art Nouveau, ses accoudoirs de fenêtres en ferronnerie, sa loggia richement décorée, son élégante véranda ou encore ses céramiques ornées de tulipes.
Aujourd’hui, ces résidences patrimoniales, encore largement préservées, témoignent d’une créativité architecturale unique et continuent de fasciner, rappelant le faste et l’élégance d’une ère révolue mais profondément ancrée dans le paysage normand et méditerranéen.
Sources
> Côte Fleurie Magazine. (n.d.). Les villas de la Belle Époque. Disponible sur https://www.cotefleuriemagazine.fr/les-villas-de-la-belle-%C3%A9poque
> eMag Calvados. (n.d.). On a visité pour vous : la Villa du Temps retrouvé et ses œuvres de la Belle Époque. Disponible sur https://emag.calvados.fr/votre-calvados/on-a-visite-pour-vous-la-villa-du-temps-retrouve-et-ses-oeuvres-de-la-belle-epoque/
> AVBE. (n.d.). Association des Villas Belle Époque de Saint-Raphaël. Disponible sur https://www.avbe.fr/
> Office de Tourisme de Saint-Raphaël. (n.d.). Les villas de la Belle Époque. Disponible sur https://www.saint-raphael.com/fr/saint-raphael/patrimoine/les-villas-de-la-belle-%C3%A9poque
> GEO. (n.d.). 200 ans de bains de mer : histoire des stations balnéaires en France. Disponible sur https://www.geo.fr/histoire/200-ans-de-bains-de-mer-histoire-des-stations-balneaires-en-france-205368
Les espaces publics à la Belle Epoque
Les Espaces publics à la Belle Epoque
Les villes balnéaires et thermales ont connu un essor significatif durant la Belle Époque, attirant une bourgeoisie en quête de loisirs et de bien-être. Cet engouement a conduit à la création et à l’aménagement d’espaces publics variés, tels que des parcs, jardins, places, boulevards, avenues, eux-mêmes agrémentés de magnifiques fontaines, statues et kiosques. Ces aménagements, reflétant l’élégance et le raffinement de l’époque, visaient à offrir aux visiteurs des lieux de détente, de promenade et de sociabilité.
Les espaces publics aménagés durant la Belle Époque répondaient à plusieurs objectifs. Ils offraient des lieux de détente et de sociabilité pour les visiteurs, reflétaient le prestige et l’élégance recherchés par la bourgeoisie, et participaient à l’attractivité touristique des stations. Les parcs et jardins étaient conçus selon des principes esthétiques précis, intégrant des éléments décoratifs tels que des fontaines, des statues et des kiosques à musique. Les boulevards et avenues, souvent bordés d’arbres, facilitaient la circulation tout en offrant des promenades agréables.
De nombreuses stations de villégiature emblématiques telle que Cabourg, Houlgate ou Bagnoles-de-l’Orne, Saint-Raphaël, possèdent des espaces publics caractéristiques de cette période qui témoignent de l’architecture et de l’art paysager de la Belle Époque.
La ville de Cabourg est indissociable de la Belle Époque. Elle a su préserver son charme d’antan, notamment à travers sa Promenade Marcel Proust. Cette promenade en front de mer, longue de près de quatre kilomètres, est bordée de villas aux façades élégantes, typiques de l’architecture balnéaire de la fin du XIXᵉ siècle. Les visiteurs peuvent y admirer des jardins soignés, des kiosques et des bancs invitant à la contemplation de la Manche. Marcel Proust, qui séjourna régulièrement à Cabourg, s’inspira de cette atmosphère pour décrire Balbec dans son œuvre « À la recherche du temps perdu ».
Houlgate est quant à elle réputée pour sa Promenade Roland-Garros. Cette avenue, qui longe la plage, offre une vue imprenable sur la mer. Elle aussi aménagée durant la Belle Époque, elle est bordée de villas aux styles variés, témoignant de l’éclectisme architectural de l’époque. Des jardins publics agrémentés de fontaines, de statues et de massifs floraux, jalonnent la promenade et offrent aux promeneurs un cadre idyllique pour la flânerie. Le nom de la promenade rend hommage à l’aviateur Roland Garros, qui passa plusieurs séjours à Houlgate.
Bagnoles-de-l’Orne, station thermale de renom, possède un Quartier Belle Époque remarquablement préservé. Construit entre 1886 et 1914, ce quartier résidentiel est composé de villas aux façades polychromes, dotées de toitures originales et de bow-windows. Les rues arborées, les places ornées de kiosques à musique et les jardins paysagers reflètent l’art de vivre de la bourgeoisie de l’époque. Les visiteurs peuvent y admirer des éléments décoratifs tels que des fontaines et des statues, témoignant du raffinement architectural de cette période.
Située sur la Côte d’Azur, Saint-Raphaël a connu un développement significatif durant la Belle Époque, attirant une clientèle prestigieuse. La Promenade des Bains, aménagée le long du littoral, est un incontournable de cette période. Bordée de palmiers, elle offre aux promeneurs une vue panoramique sur la mer Méditerranée. Un kiosque à musique, des fontaines et statues jalonnent le parcours, reflétant le goût prononcé de l’époque pour l’ornementation.
Tous ces espaces publics, témoins de l’importance accordée à l’urbanisme et à l’esthétique urbaine durant cette période, participaient à l’attractivité touristique des lieux de villégiature de la Belle Époque et font encore tout leur charme aujourd’hui.
Sources
> Carribon, C. (2014). Villes d’eaux, villes de loisirs : L’exemple des stations thermales françaises de la fin du XIXᵉ siècle aux années trente. Histoire urbaine, (41), 83-103. Disponible sur https://shs.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2014-3-page-83?lang=fr
> GEO. (n.d.). 200 ans de bains de mer : histoire des stations balnéaires en France. Disponible sur https://www.geo.fr/histoire/200-ans-de-bains-de-mer-histoire-des-stations-balneaires-en-france-205368
> Ville de Saint-Raphaël. (2024). Saint-Raphaël officiellement membre de l’association « Ville Belle Époque». Disponible sur https://www.ville-saintraphael.fr/information-transversale/actualites/saint-raphael-officiellement-membre-de-lassociation-ville-belle-epoque-9683
L’essor des bâtiments culturels à la Belle Epoque
La Belle Époque fut une période de rayonnement artistique et culturel qui transforma les paysages urbains et balnéaires. Tandis qu’à Paris fleurissaient les théâtres, opéras, salles de concert et cafés-théâtres, les stations balnéaires et thermales telles que celles du Réseau Ville Belle Époque – Saint-Raphaël, Cabourg, Bagnoles de l’Orne, Houlgate et Spa – adoptaient une approche unique. Ces villes condensèrent leur activité culturelle autour d’un bâtiment emblématique : le casino.
Dans toutes les grandes villes de France, et plus particulièrement à Paris, la Belle Époque fut synonyme d’une effervescence culturelle sans précédent. Les grands projets urbanistiques et les progrès technologiques favorisèrent l’ouverture de lieux de spectacle luxueux. Le Palais Garnier (opéra inauguré en 1875) et le Théâtre des Champs-Élysées (1913) incarnent parfaitement le faste et l’éclectisme architectural qui caractérisent la période. Les cafés-théâtres et les cabarets, tels que les Folies Bergère ou le Moulin Rouge, attiraient un public varié, mêlant l’élégance bourgeoise et la bohème artistique. Ces espaces proposaient une programmation foisonnante : opérettes, récitals, ballets, et revues modernes.
Cette vie artistique débordante inspira le développement de l’offre culturelle dans les stations balnéaires et thermales, qui cherchaient à attirer une clientèle raffinée en quête de détente et de divertissement. Les casinos jouèrent un rôle central dans ces lieux de villégiature, en réunissant sous un même toit les fonctions de théâtre, de salle de concert et de salon mondain.
Ce fut notamment le cas dans les villes aujourd’hui adhérentes de l’association Ville Belle Époque, dont les nombreux casinos ont longtemps été le cœur battant.
À Saint-Raphaël, le Casino des Neuf Muses constituait une véritable institution depuis 1882. Situé boulevard Félix Martin, il abritait des salons pour la Société littéraire et artistique ainsi que le Cercle des chasses et régates. Sa grande salle, inspirée des palais princiers, accueillait des artistes prestigieux comme le comédien Coquelin Cadet ou la soprano Caroline Miolan-Carvalho, qui charma le public avec l’Ave Maria de Gounod en 1887.
À Cabourg, le Grand Hôtel Belle Époque et son casino étaient des hauts lieux de l’élégance mondaine. Immortalisés par Marcel Proust dans À la recherche du temps perdu, ils incarnaient un art de vivre associant culture et villégiature.
À Bagnoles de l’Orne, le Casino offrait une expérience intimiste avec des spectacles et des lectures pour une clientèle élitiste, en quête de calme et de raffinement.
La Galerie Léopold II à Spa, en Belgique, illustre également cet éclat Belle Époque. Adjacente au casino, elle était un lieu d’expositions et de promenades couvertes, combinant architecture somptueuse et activités culturelles.
L’architecture des casinos Belle Époque, élégante et imposante, reflétait l’esprit du luxe de l’époque. Inspirés des opéras et théâtres parisiens, ces bâtiments intégraient des éléments de style Art nouveau et Art déco. Ils servaient non seulement de lieux de divertissement mais également de vitrines pour le prestige des villes qui les accueillaient.
Ces infrastructures culturelles ont durablement marqué l’identité des villes et continuent aujourd’hui d’incarner l’élégance et le raffinement de cette époque faste.
SOURCES
> Casinos et histoire du spectacle : Une introduction. (n.d.). Société d’Histoire du Théâtre. Disponible sur https://sht.asso.fr/casinos-et-histoire-du-spectacle-une-introduction/
> Architecture des loisirs en France dans les stations thermales et balnéaires. (n.d.). Presses Universitaires François-Rabelais. Disponible sur https://books.openedition.org/pufr/637
> Spectacles et Casinos en France. Recensement et bibliographie. (n.d.). Société d’Histoire du Théâtre. Disponible sur https://sht.asso.fr/spectacles-et-casinos-en-france-recensement-et-bibliographie/
Les établissements et équipements balnéaires
Les nouvelles pratiques et premiers bains de mer
Les premières baignades à la plage sont bien différentes de celles que nous pratiquons aujourd’hui.
Le bain moderne commence seulement au XVIIe siècle en Angleterre, dans le Yorkshire et plus précisément à Scarborough bordé par la mer du Nord. À la fin des années 1620, des médecins découvrent les vertus thérapeutiques du sulfate de magnésium contenu dans l’eau de source locale et une station thermale voit rapidement le jour sur la plage, aux pieds des falaises, où les malades viennent recouvrer la santé en respirant l’air salin. Puis la cure évolue, il faut s’immerger dans l’eau froide de la mer, nus, sous la surveillance de soignants.
La pratique se répand en France. Ainsi Dieppe devient la première station balnéaire de France dès la fin du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, l’aristocratie s’y retrouve pour suivre l’exemple de la duchesse de Berry, belle-fille de Charles X, qui aurait été la première à lancer cette mode mondaine dès 1824.
Au fil des ans, de nombreuses stations s’installent le long des côtes françaises : à Boulogne-sur-Mer, La Rochelle, Cherbourg, Deauville, Arcachon, Biarritz ou Saint-Raphaël et Cannes.
La pratique des bains hydrothérapiques est toujours effectuée dans un cadre médical : les immersions dans l’eau de mer ne doivent pas durer plus de 10 minutes. Le « maitre baigneur » plonge son patient dans la vague : c’est le bain à la lame. On buvait aussi l’eau de mer qui était diurétique, vermifuge et purgative. Le bain à la corde est certainement le bain qui a demeuré le plus longtemps : des cordages étaient tendus au ras de l’eau pour se soigner.
Le XIXe est un siècle pudibond et même si la Duchesse de Berry s’est lancée nue dans la mer, il faudra toutefois se couvrir d’un costume de bain. Dans un arrêté municipal du 24 juillet 1857, le maire d’Arcachon rappelle le port de la tenue réglementaire pour la baignade : « Article I : il est défendu de se baigner sans être revêtu, à savoir : les hommes, d’un costume entier couvrant le corps depuis le cou jusqu’aux talons, ou d’un large pantalon et d’une chemisette ; les femmes d’une robe prenant également au cou et descendant jusqu’aux talons, ou bien d’une robe courte mais avec pantalon. Les étoffes des costumes de bain, excepté celle de la chemisette, tolérée pour les hommes, devront être de couleur foncée… »
La roulotte de bain permettait de pouvoir s’immerger dans la mer et de revenir sur le sable une fois changé, c’était l’idéal et beaucoup d’établissement des bains proposaient ce service.
A Saint-Raphaël, des bains de mer fortifiants sont proposés plage du Veillat. L’établissement des bains, construit en 1878 par la famille Lambert, est complété de petits pavillons qui facilitent l’accès à l’eau vivifiante. Le docteur Bontemps, dans de nombreux écrits, traite de l’influence des bains de mer sur la santé publique, en complément de ses observations sur le traitement par l’ozone.
Les temps changent après la Grande Guerre, la plage devient peu à peu un lieu de plaisir, de détente et de relaxation. On commence même à pratiquer des sports sur la plage, inspirés des jeux olympiques antiques.
Les casinos et les lieux de spectacle.
Le casino est l’édifice de représentation par excellence de la station (Ralph Tegtmeier, Les casinos dans le monde, Arbook International, 1989). Reprenant un décret de 1808, la loi de 1907 autorise les jeux de hasard « dans des locaux spéciaux, distincts et séparés » pendant la « saison des étrangers ». Le ministère de l’Intérieur y exerce un contrôle de validation à l’ouverture et une étroite surveillance des joueurs, notamment pour détecter les escrocs qui se déplacent de casinos en casinos, entre les villes balnéaires et les villes thermales. Outre les jeux d’argent, le casino permet aussi de jouer à des jeux de « société » comme les jeux de cartes, les échecs, le tric-trac ou les dominos.
La présence du casino est un signe distinctif de l’importance de la station. Les petites plages ne possèdent pas de casinos et seules les stations thermales réputées bénéficient de leur présence. Dans les petites stations, des « salons » s’ouvrent dans les hôtels (Trouville ou Houlgate au début), ou sont abrités dans des « cercles » indépendants et privés, comme à Salies-de-Béarn. Les salons et les cercles, aux statuts privés particuliers offrent à la clientèle des baigneurs et des curistes des salles de conversation, de lecture, de correspondance, de réunion et de jeux (billard notamment) avec une bibliothèque et un fumoir.
Durant la première moitié du XIXe siècle, salons, salles de jeux, salles de sports (escrime) et de spectacles sont le plus souvent intégrés à l’établissement de bains. Dans les stations balnéaires, la double fonction du casino associé à l’établissement de bains ou à l’hôtel persiste également, parfois jusque dans les années 1920, particulièrement dans les villages thermaux.
A Saint-Raphaël, la vie artistique et mondaine est insufflée depuis 1882 par le Casino aux neuf muses, boulevard Félix Martin. Le Cercle des chasses et régates ainsi que la Société littéraire et artistique y ont leurs salons réservés. Dans sa grande salle à l’air princier, se tiennent représentations théâtrales, concerts, conversations, lectures, fêtes intimes et bals pour un public raffiné, élégant, dont les silhouettes féminines se dessinent en crinoline, en frac pour les hommes. Des artistes de grande renommée s’y produisent, tel le comédien Coquelin Cadet ou la soprano lyrique Caroline Miolan-Carvahlo qui chantera l’Ave Maria de Gounod en 1887, lors de l’inauguration de l’église Notre-Dame de la Victoire.
La majorité des stations thermales et balnéaires possède un casino. La « reine des villes d’eaux », Vichy ne possède un casino-théâtre indépendant qu’en 1865. Le cycle de constructions des casinos suit celui des termes : leurs apogées se situent dans les années 1890, 1920 et après la Seconde guerre mondiale.
Dans son Encyclopédie de l’architecture et de la construction publiée en 1898 par Paul Planat, Gustave Rives recommande que le casino soit :« placé à l’endroit le plus agréable de la station balnéaire […] sa situation et son orientation ont une très grande influence sur les résultats de son exploitation. Il faut que ses abords soient d’accès faciles, larges, bien entretenus, la façade principale au soleil et, si la configuration du pays le permet, le bâtiment sera bien abrité. Autour de lui des espaces seront réservés pour les jeux et les exercices du corps ; enfin, et c’est là une des conditions essentielles de sa vitalité, il doit être à proximité du meilleur endroit de la plage où l’on se baigne, ou près de l’établissement thermal ».
Le sport pendant cette époque a connu une expansion importante, avec des disciplines qui ont évolué et pris leur forme moderne, tout en étant souvent liées à la bourgeoisie et à l’élite sociale. Voici un aperçu des sports populaires à la Belle Époque :
Le Golf
Les nouveaux paysages du bord de mer sont le lieu privilégié d’implantation de terrains de golfs dessinés le plus souvent par des architectes anglais qui les implantent sur les falaises ou sur les grandes étendues des landes et des dunes. Les Anglais, déjà installés à Pau où ils ouvrent un golf dès 1856 sont à l’initiative de la création du golf de Dinard, installé sur la commune de Saint-Briac en 1890 et de celui de Paramé-Rotheneuf implanté trois ans plus tard à La Guimorais. Colt, le créateur du Sauningdale Golf, dessine en 1912 le golf du domaine d’Abadia à Hendaye, agrandit vers 1923-1924 le golf du Phare à Biarritz, et crée en 1926 le golf de Chantaco à Saint-Jean-de-Luz. Avant 1914, on pouvait pratiquer le golf dans les stations thermales d’Aix-les-Bains, de Vichy, de Luchon, de Vittelet d’Évian.
En 1897, à Saint-Raphaël, un groupe de dix fortunés et notables anglais créent « La société civile des terrains de l’Estérel Valescure », dont Lord Rendel, son gendre Henry Gladstone), Sydney Bentall, le Comte Claude Georges Bowes Lyon (grand père de la Reine Elisabeth II, son beau-frère Augustus Jessup richissime industriel américain, le Baron Sir Lawrence Jones. Ils vont racheter une grande partie des terrains en liquidation, réalisant ensuite dans les reventes de substantielles plus-values. Le golf de Valescure est inauguré en janvier 1900 par le grand-duc Michel de Russie. Lord Rendel en est le premier président.
Le golf attire rapidement par ses compétitions une clientèle anglaise de la Riviera. La Duchesse de Malborough, parente de Winston Churchill, y prend ses habitudes, souvent en compagnie des frères du Tsar de Russie. David Lloyd George, député libéral, ex premier ministre, vient souvent se reposer et jouer à Valescure.Lord Ashcombe , apporte sa contribution avec l’agrandissement du club house.
Les tribunes de courses et les hippodromes
Des tribunes sont édifiées pour les spectateurs des courses hippiques, nautiques puis cyclistes, et les compétitions de tir. Sur le bord de mer, parapets et digues servent aussi de tribunes. De 1840 à 1897, des courses de chevaux pour le plat et les haies sont organisées sur la Grande-Grève de Saint-Malo, avant d’être transférées à partir de 1902 sur l’hippodrome installé dans la plaine marécageuse asséchée de Marville.
Dès 1859 à Deauville, le premier plan d’urbanisme de la ville nouvelle prévoit l’édification d’un hippodrome. Ce sont parfois de simples constructions en bois comme les tribunes du vélodrome ou du tir aux pigeons de Vittel construits en 1905. Avant 1914, des concours hippiques sont organisés dans les villes thermales d’Aix-les-Bains, Vittel, Plombières et Vichy.
A Saint-Raphaël, l’hippodrome comble dès 1903 la bonne société Raphaëloise. Niché au quartier des Plaines, il est à seulement 1045 kilomètres de Paris, comme le vante la publicité des grands magasins « Au Printemps », rue Charles Gounod. Courses de plat ou d’obstacles, c’est la nouvelle attraction locale où il faut être vu.
Les tribunes pour les courses de yachts utilisent plus volontiers les terrasses de bâtiments comme celles du Grand-Hôtel des Régates de Saint-Adresse (Ernest Daniel, 1907) ou du Yatch-Club de Dinard (Yves Hémar, 1932).
Saint-Raphaël voit la naissance du nautisme en 1878. Dans cette belle époque de la fin du XIXe siècle, le nautisme évoque le délassement offert par la navigation de plaisance et la pratique sportive. Le 1er septembre 1878 marque la naissance du nautisme à Saint-Raphaël avec la tenue des premières régates sous les rafales « d’un mistral impétueux ».
« Dimanche dernier, 1er septembre, grande fête chez nous. Tout comme Cannes, Monaco, Hyères et autres villes du littoral, nous avons eu nos régates et malgré la violence d’un mistral impétueux, les jeux nautiques ont été exécutés avec le plus grand succès sous les hauts bords du vaisseau école, le Souverain, également pavoisé et en présence de plusieurs milliers de spectateurs. […] Le succès ne pouvait faire défaut aux intelligents organisateurs groupés autour de M. A. Karr. Nous espérons que ce brillant début ne sera qu’un prélude et que les régates de Saint-Raphaël continueront chaque année. » Voici comment le journal Le Var relate l’événement dans son édition du 5 septembre 1878. Au passage, le rédacteur relève le « flair et le sens de l’anticipation du second membre du comité d’organisation », Félix Martin.
Elu maire trois mois plus tôt, le premier magistrat souhaite en effet associer les réjouissances, dont le nautisme, à son grand plan de création d’une ville nouvelle, d’une station balnéaire huppée. Un « Cercle des régates » se constitue le 22 janvier 1880. Les régates de 1879 voient des tribunes « remplies de monde », comme le seront celles des années suivantes, ainsi que leur première participation à la Saint-Pierre.
Au sein de l’élite raphaëloise, un couple semble avoir marqué le monde de la voile à la fin du XIXe siècle : le vicomte René de Savigny de Moncorps et son épouse Charlotte Marie Jeanne de Villers La Faye, installés dans leur propriété de l’Oustalet dou Capelan et propriétaires d’un yacht, le Nautilus ayant appartenu à Alphonse Karr. Le vicomte est membre correspondant de l’Union des yachts français à Saint-Raphaël. Le secrétaire n’est autre qu’Edouard Siegfried (villa La Péguière) propriétaire du voilier Maïlou. Parmi les sociétaires on relève notamment les noms du comte d’Harcourt (villa Le Castellet) et de Jules Lacaussade (villa Saint-Jacques). Le « gratin » du nautisme comptera également Melchior d’Agay et son Saint-Martins, Jean Goulden et son Sybille, ou encore Henri de la Fresnaye et son Nieuport.
La déclaration de guerre de 1914 marque le coup d’arrêt des régates. Mais le 5 août 1927 se tient l’assemblée générale constitutive du Club nautique de Saint-Raphaël. Son siège social est installé à la Réserve des bains en 1928, année de la reprise des régates de grande importance comme saura en organiser le Club nautique au fil des décennies et dont le centième anniversaire se profile.
Les courses traditionnelles s’ouvrent également aux sports mécaniques comme à Monte-Carlo pour l’automobile et l’hydravion.
Sources :
- Didier Hebert, op.cit., Histoire des hippodromes de Deauville, p. 47-53
- Véronique Orain, Gaëlle Delignon, Henri Fermin, « Les équipements sportifs de l’anglomanie ».
- Architecture des loisirs en France dans les stations thermales et balnéaires (1840-1939)
Bernard Toulier
Le tennis
Le Tennis, sport encore jeune, est très vite prisé des classes supérieures et bourgeoises et s’inscrit parfaitement dans ce contexte de modernité et de loisir raffiné à la Belle Époque.
Le tennis trouve son origine en Angleterre avec l’invention d’un kit portatif d’un jeu de balle appelé d’abord sphéristique. Codifié avec la création des règles du tennis sur gazon par le major Walter Clopton Wingfield, qui popularise le jeu sous le nom de « lawn tennis », l’activité fera très vite des adeptes et essaimera dans les lieux de villégiature à la mode en France.
Les grands tournois commencent à se structurer pendant cette période, avec la création de compétitions prestigieuses comme Wimbledon qui a été fondé en 1877 et est devenu l’un des événements les plus importants du tennis mondial. À partir des années 1890, d’autres tournois internationaux, tels que l’US Open et l’Open de France (Roland-Garros), sont créés.
Le tennis devient un sport élégant et un loisir aristocratique, avec des compétitions souvent organisées dans des lieux mondains tels que les jardins de châteaux, les hôtels de luxe, ou les plages. La pratique du tennis est donc un moyen de se socialiser, d’afficher son statut social et de participer à la vie mondaine de l’époque. Les tenues des joueurs sont également très soignées, les hommes portant des costumes et les femmes des robes longues adaptées à la pratique du sport.
Les vacances à la mer ou à la montagne deviennent des moments propices à la pratique du tennis. Le sport devient alors un symbole de détente, d’exercice en plein air et de raffinement. Il est souvent associé à la bonne santé et à la modernité. A Arcachon, Deauville ou La Baule, le tennis est un moyen d’améliorer l’image de la station tout en offrant une activité saine et élégante.
Si le tennis s’implante facilement dans les lieux de villégiature, c’est aussi que sa pratique est un outil de représentation et de reconnaissance propre aux élites. Jouer au tennis, dresser un court temporaire ou disposer d’un court, surtout en zone balnéaire, c’est affirmer l’appartenance à une catégorie sociale, à un mode de vie et de paraître. Dans les grandes stations, la notion de club fermé avec ses codes, son étiquette, ses club-houses majestueux, ses tournois, font partie du « jeu mondain », mais toujours dans un cadre agréable. Prenant la plume pour Le Figaro, Marcel Proust évoque d’ailleurs en 1906 cette atmosphère caractéristique des clubs de tennis huppés.
« À Houlgate, la mode est d’aller goûter au Storting, le nouveau Cercle de tennis si joliment encadré par les délicieuses collines verdoyantes […] Où nous aurons reconnu ces jours-ci, Francis de Croisset, etc.» (Proust, 1906).
L’envie de retrouver des partenaires pour partager des goûts et des idées, le besoin de se regrouper, même pour une pratique réputée individuelle comme le tennis, construit une nouvelle sociabilité́.
Le tennis de plage se développe également, où les stations balnéaires offrent des espaces dédiés au jeu sur le sable. Mais la véritable popularité vient avec le tennis sur gazon, qui est davantage associé à l’élégance et au raffinement, notamment dans des lieux comme Le Touquet ou Eaux-Bonnes.
Les hôtels de luxe, dans les stations de villégiature, ajoutent souvent un terrain de tennis dans leurs services. Les grands hôtels comme ceux de Monte-Carlo ou Cannes commencent à attirer une clientèle internationale, désireuse de pratiquer ce sport de manière régulière. Le tennis-club devient aussi une institution. Ces clubs sont des lieux de rencontre où les joueurs se retrouvent non seulement pour pratiquer leur sport, mais aussi pour socialiser et participer à des compétitions.
Parmi les grandes figures, on peut citer Suzanne Lenglen, l’une des premières grandes championnes du tennis. Née en 1899, Suzanne Lenglen va rapidement dominer la scène internationale dans les années 1910 et 1920. Son style innovant et son approche agressive du jeu vont révolutionner le tennis féminin.
René Lacoste est un autre grand nom qui émerge dans cette époque. Bien qu’il devienne plus célèbre après la Première Guerre mondiale, son influence sur le développement du sport et de son image débute pendant la Belle Époque.
A consulter : Tennis, « Leisure class » et nouvelles représentations du corps à la Belle Époque .- JEAN-MICHEL PETER
L’avion
« Le Français Blériot vient de traverser la Manche en aéroplane. C’est l’envoyé spécial du Matin qui l’a accueilli sur la terre anglaise et qui en élevant le drapeau français lui a fait le signal de l’atterrissage » Le Matin, 25 juillet 1909.
À partir du début du XXe siècle, en France, la presse vit au rythme des exploits techniques et sportifs des aviateurs. Les quotidiens nationaux et régionaux s’appuient sur la nouveauté et le caractère stupéfiant de l’aviation naissante pour augmenter leurs tirages, devenant souvent eux-mêmes les principaux acteurs de cet élan à travers la création d’épreuves retentissantes.
Cette fièvre aviatrice témoigne du travail d’acculturation accompli par une presse d’information qui invente littéralement une forme de théâtralité de l’exploit aérien et forge de nouveaux outils médiatiques. Après les succès du vélo et de l’automobile, l’essor brutal de l’aviation vient en effet renouveler les perspectives de la mobilité et transformer les perceptions du temps et de l’espace. Une accélération s’intensifie qui renvoie à plus d’immédiateté, de vitesse.
Sur les côtes nombreux aviateurs séjournent et n’hésite pas à battre des records, organiser des baptêmes de l’air et s’exercer dans l’air, sous le regard émerveillé des villégiaturistes avides de sensations fortes et d’aventure.
Source : ROBENE Luc, BODIN Dominique, « Le feuilleton aéronautique à la Belle Époque », Le Temps des médias, 2007/2 (n° 9), p. 47-62. URL: https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2007-2-page-47.htm
La bicyclette et la moto
La bourgeoisie incarne la « classe de loisir » par excellence. La pratique du sport, les loisirs, l’hédonisme et l’oisiveté sont avant tout des moyens de rendre visible, de manière ostentatoire, l’étendue de sa richesse. De fait, les bourgeois disposent d’un capital temps et de moyens que n’ont pas les classes populaires. Les vacances sont alors réservées à une élite. La villégiature, une pratique à l’origine aristocratique, est favorisée par développement de l’automobile et des chemins de fer. Le premier Guide Michelin est édité en 1900 et les premiers Guides Joanne le sont en 1907.
L’usage de la bicyclette, qui est avant tout un loisir bourgeois dans les années 1890, finit par se populariser au début du XXe siècle après la création des premières grandes épreuves cyclistes comme le premier Tour de France en 1903, mais la plupart des sports restent des marqueurs des loisirs bourgeois, comme le tennis, l’alpinisme, l’escrime ou le golf.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Belle-Epoque
L’évolution du vélocipède vers le grand-bi dans les années 1870-1880 est internationale. L’augmentation du diamètre de la roue avant permet d’accroître la vitesse. Mais sa pratique périlleuse encourage le développement des bicycles de sécurité et des tricycles qui touchent une large clientèle, dont les femmes.
La bicyclette moderne s’impose dans les années 1890. Désormais dotée de deux roues d’égal diamètre et de pneumatiques, elle est équipée d’une transmission à chaîne. Aux côtés de cet archétype, plusieurs modèles alternatifs sont représentatifs des recherches techniques qui se poursuivent à l’aube du 20e siècle.
En savoir plus : La naissance du cyclisme à Saint-Raphaël et dans l’Est varois, à la fin du 19ème siècle – Par Alain Droguet (Bulletin de la Société d’histoire de Fréjus et de sa région – n°21-2020) : https://www.shfr.fr/_files/ugd/f620b8_7aea855133ea41c7b876dd369d721626.pdf
Les origines de la moto se trouvent à la fois dans le vélocipède à vapeur de Louis-Guillaume Perreaux (1871) et dans le tricycle à moteur, qui rencontre un franc succès dans les années 1895. Mais les premières années du 20e siècle constituent des moments cruciaux et fondateurs : évolutions techniques majeures, meilleure fiabilité des bolides, développement industriel et commercial, multiplication des courses, leadership des fabricants français.
Source : L’épopée fantastique 1820-1920, cycles et motos 8 avril – 25 juillet 2016 Musée national de la Voiture du Palais de Compiègne.
En 1900, le Touring-club de France est fort de 75 000 membres
Source François d’Hubert. Enquête d’évasion : le voyage cyclotouriste dans la France de l’entre-deux-guerres. 2014.
Le rallye et le circuit touristique
En 1894, c’est lors d’un Paris-Rouen que le rallye (mot d’origine anglaise signifiant course automobile) puise ses origines. Cette course récompensait l’équipage qui ralliait deux points donnés, en un temps minimal. Par la suite, en 1911, c’est le rallye Monte-Carlo qui voit le jour.
L’automobile devint un loisir et un objet de plaisir et la femme délaissée comprit rapidement qu’accompagner son mari pouvait être synonyme de liberté et de découvertes. Les magazines féminins mirent en relief le phénomène et vinrent rapidement les concours d’élégance : voitures d’exception et chauffeurs accompagnés de femmes bien habillées avec des chapeaux très originaux. Au cours de promenades découvertes c’était aussi l’occasion pour les femmes de défiler avec des tenues à la dernière mode et ainsi de mettre en valeur les grands couturiers, avec un prix à la clé !
La naissance du spiritisme
Au cours de la Belle Époque, le monde traverse une période de grands progrès industriels : les gens sont déstabilisés et en perte de repères. Mouvement fantaisiste et anecdotique à l’origine, le spiritisme devient très vite un véritable phénomène. En 1897, 8 millions de personnes sont adeptes dans le monde… Aujourd’hui encore, le spiritisme est la 3e religion du Brésil ! D’origine américaine avec les sœurs Fox, le spiritisme devient un mouvement populaire et durable sous l’impulsion d’Allan Kardec. En France, il devient vite intellectuel. Des personnalités littéraires reconnues comme Victor Hugo, Arthur Conan Doyle, Alexandre Dumas… en sont férus. Victor Hugo aurait communiqué avec pas moins de 112 esprits, Shakespeare, Mahomet, Napoléon, Molière ou encore Jésus lui-même ! Les médiums sont très inspirés pour mettre en scène leur salon : guéridon « qui tourne » et qui bouge seul. Les journaux, les spectacles contribuent à développer la mode des spectres et le développement de la photographie permet de capter des images de fantômes et de consoler les vivants en se jouant de leur crédulité.
Source : Article de Marc-Paul LEMAY Publié le 08/07/2020 dans la Renaissance du Loir et Cher
Les industries et infrastructures de transport
La Révolution industrielle a introduit des innovations majeures qui ont modifié la production et les infrastructures dans les pays industrialisés. Elle a créé un environnement propice aux avancées technologiques dans de nombreux domaines, y compris le transport. Ce processus s’est accéléré au cours de la Belle Époque, avec des progrès qui ont marqué une rupture par rapport aux modes de transport traditionnels et permis de grandes avancées dans la mobilité des personnes et des marchandises.
Le train
L’histoire des chemins de fer commence en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIème et au début du XIXème siècle puis progresse en quelques décennies au fur et à mesure des progrès techniques, pour donner lieu à l’intense développement ferrovière des années 1840. Le chemin de fer devient alors le mode de transport terrestre dominant pendant près d’un siècle, avant d’être supplanté, depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale par letransport routier automobile et concurrencé par le transport aérien.
Le chemin de fer permet des déplacements rapides et sûrs, pour les personnes comme pour les marchandises. Ill contribue ainsi à la révolution industrielle, à la capitalisation et au développement du secteur financier et du commerce, et au développement urbain qui caractérisent le siècle, en Europe et aux Etats-Unis, tout en bénéficiant en retour des avancées technologiques du siècle et des moyens d’investissement importants que nécessitent ses coûteuses infrastructures.
Alors que les transports par voie de terre sont encore largement tributaires de la force animale – les premiers véhicules à moteur n’apparaissent qu’à la fin du XIXe – le chemin de fer permet de desservir les villes et les campagnes grâce à des réseaux maillés et à l’utilisation de différents écartements, les plus étroits permettant à moindre coût d’atteindre des localités reculées ou d’affronter le relief en zone de montagne.
Parallèlement à ces progrès, l’industrie ferroviaire ne cesse d’améliorer les conditions de vitesse et de confort en particulier pour le transport de voyageurs.
Le train et la villégiature
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’existence d’une ligne de chemin de fer est la condition sine qua none du développement de la station balnéaire. C’est en effet le moyen de transport le plus rapide pour se rendre sur son lieu de villégiature. Ainsi, s’il fallait 12 heures en voiture attelée pour se rendre de Paris à Dieppe en 1840, le voyage ne durait plus que 4 heures en train sous le Second Empire. Les premiers « trains de plaisir » lancés en 1848, permettaient de rejoindre depuis la campagne, la côte normande, pour de courts séjours en fin de semaine. Le bourgeois pouvait s’offrir un voyage en train de luxe pour aller à Trouville-sur-Mer moyennant le paiement d’un billet qui équivalait à 20 journées de travail d’un ouvrier. Le domestique, quant à lui, payait un billet dix fois moins cher. Alors que la côte normande est fréquentée par un public mondain, la Bretagne et le Cotentin accueillent sur leurs plages un public familial. Pour atteindre ces lieux de villégiature, les tarifs ferroviaires étaient moins élevés…
Le PLM, Paris-Lyon-Méditerranée,
La Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, désignée sous le nom de Paris-Lyon-Méditerranée ou son sigle PLM, est l’une des plus importantes compagnies ferroviaires privées françaises entre sa création en 1857 et sa nationalisation en 1938, lors de la création de la SNCF.
le PLM était la compagnie par excellence des départs en villégiature, desservant le sud-est de la France, en particulier la Côte d’Azur, Provence, les Cévennes et les Alpes, depuis la Gare de Lyon à Paris.
La compagnie proposait également de nombreuses lignes desservies par des autocars et possédait des hôtels en lien avec ceux-ci. L’une de ces lignes était la route des Grandes Alpes, itinéraire touristique promu par le Touring-Club de France et la compagnie du PLM.
La PLM devient célèbre pour ses affiches commerciales installées dans les gares, qui font la promotion des destinations de leur trains dans les villes d’eaux, avec notamment les bienfaits des eaux et les monuments caractéristiques, mais aussi des stations de villégiature de la Côte d’Azur.
Saint-Raphaël est desservie par les premiers trains de la compagnie du PLM en 1864, permettant l’arrivée des premiers villégiateurs. Devenue une station balnéaire attractive depuis 1880, avec ses hôtels de première catégorie, casino, église paroissiale, bains, promenade le long du rivage, villas de style, tous les trains font halte à Saint-Raphaël, y compris les trains de luxe. Très vite, la petite halte ne répond plus aux besoins d’accueil de la haute société. Le maire de l’époque, Félix Martin, décide en 1886 de la construction d’une gare de style néoclassique ornée de fresques et agrémentée d’une marquise. Celle-ci prend bientôt le nom de « Saint-Raphaël-Valescure », bien identifiée par la colonie anglaise. Les petites gares édifiées dans les quartiers permettent le désenclavement et l’épanouissement des stations. Boulouris en est doté en 1881, Le Dramont (halte) en 1895, Agay et Le Trayas en 1908, Anthéor en 1932.
Les Navires
Les voyages transatlantiques ont également joué un rôle clé dans le transport à la Belle Époque, en particulier entre l’Europe et l’Amérique. Les paquebots, comme ceux de la compagnie Cunard ou le Titanic de la compagnie White Star Line (bien qu’il ait coulé en 1912), représentaient l’apogée du confort et du luxe pour les voyageurs traversant l’Atlantique. Ces navires étaient un symbole de l’ère industrielle, marqués par des technologies de pointe et des aménagements somptueux.
Le Métro
Le métro, ou chemin de fer souterrain, a vu le jour à la Belle Époque. La première ligne de métro de Paris, le Métropolitain, a ouvert en 1900, à l’occasion de l’Exposition universelle de Paris. Ce réseau de transport souterrain a rapidement révolutionné la mobilité urbaine, permettant aux Parisiens de se déplacer facilement dans une ville en pleine croissance. Le métro a été rapidement suivi par d’autres grandes villes européennes, comme Londres (avec son Underground) et New York.
La musique
La musique à la Belle Époque
En musique cohabitent un post-romantisme encore plein d’une fièvre sentimentale, un symbolisme dont Debussy est la figure de proue et une passion pour la sensualité de l’Orient. La musique rassemble toutes ces influences sans oublier l’inspiration sacrée et l’engouement pour la virtuosité instrumentale.
La période musicale allant de 1870 à 1900 est celle des “post-romantiques”. La révolution industrielle du XIXe siècle a donné naissance à une classe moyenne dont les goûts musicaux s’orientent vers :
– recherche d’une musique plus facile : c’est le triomphe de la valse (Johann Strauss fils) et de l’opérette (Offenbach) ; Emmanuel Chabrier introduit l’humour en musique ;
– le romantisme poussé à son paroxysme : expression extrême des sentiments (Tachaïkowski), prédominance de la musique à programme (Strauss) , gigantisme de l’orchestre (Bruckner, Mahler);
– exacerbation de l’identité individuelle, mais aussi nationale : recherche des racines, inspiration du folklore.
Les écoles nationales voient le jour, souvent représentées par un musicien ou un groupe de musiciens : en Russie par exemple, c’est le Groupe des cinq. En Tchécoslovaquie, on trouve Bedrich Smetana et Anton Dvořák, puis Leos Janacek; puis plus au nord : Edvard Grieg en Norvège et Johan Jean Julius Christian Sibelius en Finlande.
Dans les anciennes cultures musicales, se développe également un sentiment national :Isaac Albézinet, et Granados représentent l’Espagne ; Saint-Saëns fonde la Société nationale de musique pour populariser la musique française (les membres les plus éminents en sont César Franck et Gabriel Fauré); en Italie, le courant vériste (Giacomo Puccini) illustre la conquête de l’indépendance du pays.
Cette période est celle de deux immenses compositeurs : Brahms, sorte de classique-romantique autrichien, et Bizet, jalon incontournable de l’opéra français avec Carmen.
La période 1900-1930 est extrêmement contrastée sur le plan musical comme dans tous les autres domaines de la culture (littérature, philosophie, arts plastiques…)
Parallèlement à des tendances hyper-romantiques (Puccini, Mahler, Strauss, Rachmaninov…) on constate le retour à une expression plus tempérée, à travers notamment « l’ impressionnisme musical » ( Debussy, Ravel, Sibelius, Falla) et l’affirmation des identités nationales (Janáček, Albéniz, Sibelius, Falla…).
Le langage musical se libère de plus en plus des contraintes de la tonalité. Même pour les compositeurs encore attachés aux formules anciennes (Mahler, Strauss, Paul Dukas…) , la tonalité se dissout de plus en plus dans le chromatisme. Plus encore, la Belle Epoque ouvre des voies inédites : Modalité (Debussy, Ravel), atonalité (Schönberg), esprit Dada (Satie)
Vincent d’Indy et la Schola cantorum
Vincent d’Indy (1851-1931) a occupé une place centrale dans la vie musicale française à la Belle Époque. Originaire du Midi de la France (bien que né à Paris), élève de Diemer et de Marmontel, pour le piano, de Lavignac pour l’harmonie, enfin — et surtout — de César Franck auquel il voue un culte qui ne cessera de grandir, il complète sa formation musicale par plusieurs voyages en Allemagne. Il y rencontre Liszt, Brahms, Wagner surtout ; la découverte des drames lyriques de ce dernier va orienter toute sa carrière. Après ses premiers succès, celui en particulier de sa Symphonie cévenole (1886), il prend la direction de la Société nationale à la mort de Franck (1890) et fonde la Schola cantorum dont il deviendra très vite le directeur. Dès lors, son influence sur la jeune génération devient très importante non seulement dans le domaine musical mais sur le plan moral. D’Indy ne sépare jamais son enseignement artistique d’une attitude philosophique et morale. Son esthétique, fondée sur le culte de l’ordre, de la rigueur, n’est dans son esprit que l’application au domaine de l’art d’une pensée morale. C’est parce qu’il est fervent catholique, et parce qu’il est nationaliste, qu’il tentera de traduire en français le message wagnérien et cherchera son inspiration dans ses montagnes cévenoles. C’est au nom d’une certaine conception morale qu’il s’opposera vivement au « debussysme », trop sensuel, trop peu structuré à son goût, et cela malgré une grande admiration personnelle pour l’œuvre de Debussy ; son école et ses disciples, renchérissant sur son rigorisme, le pousseront peut-être plus loin qu’il n’eût souhaité lui-même.
Reynaldo Hahn et la musique de salon
C’est principalement dans les salons parisiens de la noblesse et de la haute bourgeoisie de la Belle Époque que se côtoyaient musiciennes et musiciens, artistes, hommes et femmes de lettres, politiques, personnalités diverses, lors de séances musicales annoncées par la presse (Le Gaulois ou encore la rubrique « Le Monde et la Ville » du Figaro).
Reynaldo Hahn (1874-1947) est amené à y composer ses chœurs qui, à côté de mélodies et d’airs d’opéras, sont interprétés par les chanteuses et chanteurs amateurs éclairés. Ceux-ci appartiennent à ces cercles mondains, placés sous la houlette de chefs tels que Félix Raugel (alors étudiant à la Schola cantorum, fondateur en 1909 de la « Société Haendel », aux côtés d’Eugène Borrel), Charles Bordes (le chef de chœur de la Société des Chanteurs de Saint-Gervais, fondée en 1892), Jules Griset (qui dirige la Société chorale d’amateurs, fondée en 1887 par Antonin Guillot de Sainbris), Walther Straram (alors chef de chant à l’Opéra-Comique), Abel Duteil d’Ozanne (qui dirige les chœurs de l’Euterpe, chez la princesse de Polignac), Désiré-Émile Inghelbrecht (qui fonde, à partir de 1912, l’Association chorale professionnelle de Paris), Camille Saint-Saëns mais aussi Hahn lui-même. En 1895, Gabriel Fauré est lui aussi sollicité par Marguerite de Saint Marceaux afin de monter une chorale d’amateurs pour les habitués de son salon.
Reynaldo Hahn (1874-1947) est une figure musicale emblématique de la IIIe République. Le catalogue de ses œuvres accorde une place privilégiée à l’opéra (L’Île du rêve, La Carmélite, Nausicaa, Le Marchand de Venise), aux opérettes et aux revues (Ciboulette, Mozart, Une revue, Brummel, Ô mon bel inconnu), sans oublier scènes lyriques et motets religieux, même s’il comporte de nombreuses pièces pianistiques, symphoniques (concertos, ballets, musiques de scène et de film), ou encore de musique de chambre. Hahn doit surtout sa célébrité à ses très nombreuses mélodies pour voix et piano qu’il se plaisait à chanter lui-même tout en s’accompagnant au piano.
Dans ces lieux de sociabilité se croisent différents artistes dans un contexte d’échanges et de créations mais aussi, dans le domaine musical, différents réseaux comme ceux de la Société nationale (créée en 1871) et de la Schola cantorum (fondée en 1894 et inaugurée en 1896), ou encore des musiciens professionnels et des amateurs éclairés.
La plupart des salons mondains de la Belle Époque étaient tenus par des femmes fortunées. Héritières ou mariées à des personnes aisées, ces amatrices d’art ou artistes pour certaines comme Madeleine Lemaire, faisaient profiter leurs convives de spectacles musicaux assurant un casting d’invités triés sur le volet. Lieux de fêtes et de cultures comme chez la Princesse de Polignac, ces salons étaient parfois des lieux plus politiques où se retrouvaient les intellectuels dreyfusards dont faisait partie Reynaldo Hahn. Ce dernier fréquentait tellement ces lieux de mondanités qu’il fût souvent qualifié de « compositeur de salon », son œuvre restant parfois confidentielle en dehors des appartements cossus de l’Ouest parisien.
Reynaldo Hahn a pour compagnon fidèle du conservatoire, le pianiste Édouard Risler. Il y a aussi Marcel Proust, alors jeune écrivain qui semble très proche de lui dans les soirées. N’ayant pas la nationalité française, le compositeur ne peut pas concourir au prix de Rome comme ses camarades du conservatoire. De plus, ses deux ouvrages lyriques, L’Île du Rêve et la Carmélite n’ont pas obtenu le succès qu’ils méritaient et demeurent confidentiels. C’est donc dans les salons, avec ses mélodies, que Reynaldo Hahn trouve la légitimité. En 1890 Reynaldo Hahn accompagne son ami du conservatoire, le pianiste Édouard Risler, chez Alphonse Daudet. Le fameux auteur des Lettres de mon moulin reçoit avec sa femme Julia le jeudi soir au 31 rue de Bellechasse à quelques pas des Invalides. On y rencontre les personnalités du cercle littéraire : Edmond de Goncourt, Stéphane Mallarmé, Émile Zola… Alphonse Daudet décide de prendre Reynaldo sous son aile. Il se délecte en écoutant ses mélodies sur des poèmes de Verlaine et admire ce « perpétuel souci de reléguer la musique au second plan ». Edmond de Goncourt aime lui aussi la « musique littéraire » de Reynaldo Hahn. « Vous avez une voix adorable, lance-t-il, vous finirez par me faire aimer la musique ! ».
Les cafés-concerts
Les cafés ou l’on chante, les cafés-concerts, se multiplient à la Belle Époque. Chaque quartier de Paris va en avoir plusieurs, ainsi que la plupart des villes de province. La chanson était faite pour être écoutée, elle deviendra alors un spectacle. Devenus plus simplement « caf’conc », ils sont appelés par la Bourgeoisie des beuglants, ce qui n’empêche pas les bourgeois de les fréquenter. Pour donner un air plus convenable à ces établissements, la Préfecture de Police impose « la corbeille » : Sur la scène, assises derrière les artistes, des jeunes femmes en tenue de soirée et maniant l’éventail avec élégance, appelées les poseuses, tentent de donner l’impression d’un salon. Cette règle va perdurer plus longtemps en province qu’à Paris. L’une d’elles, à La Rotonde de Moulins, a séduit dès 1904 le public en chantant Ko Ko Ri Ko, ou Qui qu’a vu COCO dans l’Trocadéro , ce qui lui vaudra le surnom qu’elle a gardé quand elle est devenue la grande Coco Chanel, qui habillera les vedettes des revues.
Monsieur Lorge, directeur de l’Eldorado, l’un des grands caf’conc parisiens situé Boulevard de Strasbourg, aidé par une campagne de presse acquise à sa cause, obtient, après un procès retentissant, le droit alors réservé aux acteurs, d’utilisation par les chanteurs d’accessoires et de costumes. Dès lors, chanter devient un spectacle à part entière. On viendra y applaudir les grandes vedettes de l’époque : Theresa, Judic, Bonnaire, Paula Brebion, ou Kam-Hill qui entrait sur scène à cheval, et celui qui restera le plus grand comique de son temps, l’extraordinaire Dranem avec ses chansons fantaisistes, comme : Pétronille tu sens la menthe, J’ai un trou dans mon quai, ou Romance subjonctive, sans oublier l’immortel Les p’tits pois.
En face, La Scala, où l’on a pu entendre Libert, Ouvrard, Jeanne Bloch, ou Amiati qui électrisait la salle après la guerre de 1870 en chantant la gloire des soldats français et des Turcos, appelant à la revanche avec Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine. Une des grandes voix de la chanson, Marius Richard, y a créé Les blés d’or chanson familiale type, qui pendant des dizaines d’années sera la chanson des fins de banquets.
Parmi les nombreux cafés-concerts, il faut citer L’Alcazar, Rue du Faubourg Poissonnière, qui se déplaçait en été, pour devenir L’Alcazar d’été avec sa terrasse en plein air sur les Champs- Elysées. Les Ambassadeurs, à proximité de l’Hôtel Crillon, où logent les diplomates étrangers, devient le « Restaurant- Café- Concert » à la mode, avec un kiosque pour les chanteurs, les spectateurs étant en plein air, sous les arbres. C’est de là que partira le procès qui verra en 1854 la naissance du Syndicat des auteurs- compositeurs, aujourd’hui, la SACEM.
La fin du 19e siècle voit le déclin des cafés-concerts avec l’arrivée du music-hall. A Montmartre, s’ouvrent les Cabarets qui vont remplacer les guinguettes où les Parisiens viennent boire et danser le dimanche. Ils prennent la relève de la chanson populaire avec comme chef de file le « Chat- Noir » de Rodolphe Salis, auquel va succéder « Le Mirliton » d’Aristide Bruant.
Mais dans les caf’conc. Le déclin qualitatif continue. Les critiques et écrivains de cette époque ne se sont pas privés de stigmatiser la vulgarité atteinte par ces spectacles. Paulus lui-même, la première star du caf’conc chante dans La polka des chons-chons.
Au Moulin-Rouge qui a ouvert en 1889, outre les controversées La Goulue, La Môme Fromage, Nini-Pattes-en-l ’air et leurs consœurs, l’attraction du moment est le Pétomane dont la prestation n’est pas des plus distinguée. Fatigués des révoltes, des troubles civils, des affaires, les Français voulaient vivre gaiement, s’amuser et oublier. Le Music- Hall prend alors le relais des caf’conc.
Au début, le music-hall apparaît comme un fourre-tout, avec autour des chanteurs, des clowns, des acrobates, des excentriques. Puis arrivent les revues qui se débarrassent de l’actualité et de la satire pour se consacrer à de spectaculaires mises en scène, présentent des tableaux d’une extrême richesse, des femmes de plus en plus nombreuses autour d’une vedette de plus en plus vedette.
De nombreux artistes des cafés-concerts, devenus des interprètes célèbres, continueront leur carrière au music-hall. De nouveaux artistes viendront les rejoindre et les nouvelles vedettes du music-hall deviendront de véritables mythes faisant de Paris le lieu de rendez-vous des Rois, des Princes et des Grands- Ducs, qui s’affichent avec les « grandes cocottes », celles que la Préfecture de Police traitait comme un corps diplomatique de réserve, avec Liane de Pougy, la Belle Otero, Emilienne d’Alençon, Jeanne Granier, Mistinguett. Elles gravitent autour des spectacles dont elles sont parfois les meneuses de revues, et font la joie des chroniqueurs et du public avec leurs protecteurs, de Leopold II de Belgique à Edouard VII d’Angleterre, du Grand- Duc Alexis à Pierre de Russie.
Cette Belle Époque qui voit l’éclosion des music-halls, voit naître en même temps des artistes nouveaux, dont plusieurs connaîtront l’apogée de leur carrière après la guerre de 14/18, et traverseront cette période sans dommages, ce qui sera le cas par exemple, de Mistinguett, de Félix Mayol ou de Maurice Chevalier entre autres. La chanson symbole de cette période Frou-Frou est sur toutes les lèvres depuis que Mealy, jeune meneuse de revue l’a créée en 1897.
En 1902, alors qu’Esther Lekain crée Tout ça n’vaut pas l’amour, qui sera plus tard un succès de Maurice Chevalier, arrive à Paris la musique noire américaine et l’on danse la boston, le one-step, le rag-time, le fox-trot, ou le cake-walk, qui donnent aux revues un rythme nouveau, mais n’empêche pas la bonne vieille valse de continuer sa route. Et en 1905, Maurice de Feraudy, chante Fascination, créée par Paulette Darty. Elle sera magnifiée par Odette Joyeux.
Les revues composent en général la deuxième partie des programmes du music-hall. Elles sont menées par des vedettes confirmées. C’est à cette époque que Mistinguett ou Maurice Chevalier y apprennent le métier.
A cette époque où la musique, les costumes et le mouvement sont la base du spectacle, Yvette Guilbert qui n’a pas beaucoup de voix et qui ne sait pas chanter, va entamer une carrière internationale remarquable commencée dès le début du Moulin-Rouge, en 1889.
Le genre comique troupier prend par ailleurs une grande place à l’approche de la Grande Guerre, avec entres autres Ouvrard Fils qui parmi de nombreuses chansons a créé Si j’avais de ailes, Suzon la blanchisseuse, L’amant de la cantinière, et surtout son grand succès Je n’ suis pas bien portant.
Et en 1906, arrive à Paris dans le monde de la chanson, venu lui aussi du midi, Vincent Scotto, l’homme aux 4000 chansons auxquelles il apporte un visage nouveau. Ses premiers succès, qui restent encore dans nos mémoires collectives, comme La Petite Tonkinoise, créée par Polin, Ah ! si vous voulez d’l’amour, par Esther Lekain et Mayol, Caroline Caroline par Malloire, ou encore Sous les Ponts de Paris, par Georgel.
Le phonographe et le gramophone
Le phonographe fut inventé par Thomas Edison, alors qu’il poursuivait ses recherches sur le télégraphe et ses études sur le téléphone de Graham Bell. Théodose du Moncel présenta l’appareil à l’Académie des sciences dont il était membre, le 11 mars 1878. Étymologiquement, le mot phonographe dérive du grec ancien φωνή (phonè) : la voix ; γράφειν (graphein) : écrire.
Le phonographe permet d’enregistrer et de reproduire des sons. Son procédé est mécanique : un stylet composé d’une pointe enregistreuse interchangeable fixée sur un diaphragme, grave un sillon sur un cylindre de cuivre (remplacé plus tard par de la cire) recouvert d’une feuille d’étain malléable. C’est le déplacement du cylindre devant le diaphragme fixe qui, émettant des vibrations transmises par la pointe enregistreuse, grave ainsi sur la feuille d’étain un sillon ayant la forme d’une hélice. Une fois l’enregistrement terminée, le cylindre gravé peut être lu par le stylet, la pointe faisant vibrer le diaphragme, transformant le sillon gravé en sons.
Véritable concurrent du gramophone aux débuts de l’industrie musicale, le phonographe vit son nom perdurer, et ce même si les appareils appelés ainsi étaient techniquement des gramophones, surtout à partir des années 1910-1920. En effet dû à la proximité des techniques et des époques, et étant donné que les phonographes abandonnèrent progressivement la lecture de cylindre – on parle alors de phonographe à disques – les termes gramophones et phonographes se mélangèrent fréquemment, et finirent par être considérés comme des synonymes.
Le gramophone, est inventé et breveté par l’allemand Émile Berliner en 1887. Il se distingue du phonographe par le disque qui remplace le cylindre en tant que support d’enregistrement, et par le procédé de gravure qui se fait désormais latéralement : un va-et-vient du stylet graveur dans le plan du disque, contrairement au phonographe d’Edison utilisant un procédé de gravure verticale du cylindre.
Au cours de ces nombreuses expériences, Berliner teste plusieurs matériaux pour graver ses disques. Après avoir testé des plaques de verre enduites de noir de fumée qu’il juge insatisfaisantes, il utilise de petits disques de zinc laqué, fait à base de gutta-percha, une gomme issue du latex naturel. Ainsi commence la commercialisation des disques Berliner 5 pouces (12,5cm de diamètre). Les disques Berliner 7 pouces (17,5cm) issus d’une matière semblable à l’ébonite apparaissent ensuite aux Etats-Unis en 1895, suivis des disques 10 pouces (25cm de diamètre) en 1901 puis des 12 pouces (30cm) en 1903.
Une fois mis sur le marché, le gramophone connaît un succès immédiat. Le grand public, qui à ce moment-là découvre à peine le phonographe d’Edison, n’a pas encore réellement pris d’habitudes concernant le matériel d’écoute ou la façon d’écouter de la musique. Les deux appareils et les compagnies les représentant se livrent alors une bataille intense pour devenir la référence et imposer leurs produits dans l’esprit des consommateurs. Bien que le phonographe à cylindre connaisse un succès honorable les premières années, le gramophone remporte la bataille des supports, ce qui signifie très vite sa victoire totale. En effet, la praticité du disque est alors très appréciée des premiers acheteurs, Berliner ayant semble-t-il eu la bonne idée de penser à la discothèque du consommateur.
Dès la fin du XIXème siècle, plusieurs marques de gramophones ou de phonographes à apparaissent en Amérique du Nord et en Europe. Une forte concurrence en découle, et en plus des appareils, ces fabricants se doivent de trouver des artistes pour assurer une variété de disques et ne pas lasser l’auditeur. C’est ainsi que ces compagnies deviennent peu à peu des labels musicaux et produisent les disques de leurs artistes, qu’ils soient classiques ou populaires. S’en suit alors une période d’innovations technologiques qui pose les bases de l’industrie musicale : la durée des chansons de 4 à 5 minutes et le « play-back only » (lecture seulement).
Au cours des trente années suivantes, le succès du gramophone ne faiblit pas et de nombreuses variations du produit voient le jour. Vers 1910, les phono-valises font leur apparition. Gramophone inséré dans une valise, ce procédé se révèle à la fois pratique et innovant, l’amplification acoustique étant assurée par une cavité conique située à l’intérieur du boîtier. Cette évolution assure une meilleure diffusion du son, et une aisance de transport non négligeable et contribue à la percée du gramophone dans les foyers occidentaux. Viennent ensuite le gramophone à moteur, qui propose un son de meilleure qualité, mais aussi le gramophone miniature, transportable facilement, ou encore le gramophone meuble de grande taille, puissant et esthétique.
Le gramophone disparaît progressivement au cours des années 1940 à 1960 au profit de l’électrophone.
La danse
La danse à la Belle Époque reflète l’évolution et les bouleversements apportés par les brassages de cultures dus aux expositions universelles, au développement des transports, au progrès technique et à l’influence des nouveaux rythmes américains : En 1875 arrive Le boston américain, variante de la valse, plus lente avec des pas croisés et progressifs. C’est l’époque également du two-step, hérité de la polka, sur un rythme à deux temps.
Néanmoins, la France danse toujours la polka, la mazurka, la scottish, … Dans chaque coin de France se pratiquent les « danses sociales » qui réunissent les gens de tous âges lors des fêtes familiales ou de villages. Quelques nouveautés apparaissent comme le pas de quatre, le pas de patineur.
Le quadrille français est abandonné au profit du quadrille des Lanciers et de nombreux autres quadrilles sont créés par des professeurs de danse que l’on retrouvera dans leurs traités parus à cette époque tel que Eugène Giraudet, François Paul, Gustave Desrat, Lussan-Borel
Certaines danses ont fait scandale comme le cake-walk venant des Etats-Unis, dansé par les esclaves noirs et imité par les blancs. Introduite en Europe fin XIXe, cette danse connaît un grand succès en 1900 où elle entre dans les salons.
Sur les bords de la Seine à Chatou et au bord de la Marne, les ouvriers, les artistes, les domestiques, les lingères fréquentent les guinguettes (qui vient de guiguet, le petit vin blanc qu’on récoltait sur les coteaux) ainsi que dans certains villages autour de Paris comme à Robinson.
A Paris on fréquente les « bals musette » à Montmartre au Moulin de la Galette mais aussi dans le quartier de la Bastille rue de Lappe où se développe une nouvelle danse la Java et la Valse musette.
Les membres de la bourgeoisie fréquentent les bals qui se créent un peu partout dans Paris comme le « Bal Robert », le « Bal Bullier », le « Bal Mabille », avec le célèbre chef Olivier Metra. Des orchestres se produisent dans les cafés des Grands-boulevards où les pistes en parquet permettent aux spectateurs de danser la valse et la polka. Emile Walfteufel et les frères Strauss vont laisser plusieurs valses et polkas célèbres.
Le monde aristocratique fréquente les bals privés donnés dans les salons des hôtels particuliers de Paris et de Londres.
En 1912 apparaît un couple de danseurs anglo-américain : Irène et Vernon Castle. Ce couple marié, va donner un style élégant aux nouvelles danses, un mélange de modernité et de traditions qui leur vaudra d’être imités largement en France et aux Etats-Unis. Ils imposent de nouvelles polkas, des valses sauteuses, des bostons-hésitations, le Castle-walk, le fox-trot et le tango.
Après les années 1920, commenceront le charleston, le quick-step, le lindy, le rock à 6 temps.
La fascination pour la Russie
À la fin du XIXe siècle, les échanges culturels entre France et Russie se resserrent, conséquence d’un rapprochement politique spectaculaire. L’accord de coopération militaire signé entre la Russie et la France, en 1892, scelle une alliance durable entre les deux pays, du moins jusqu’à la chute du régime tsariste en 1917. Les visites officielles se multiplient. En 1896, le tsar Nicolas II pose à Paris la première pierre du pont Alexandre III en hommage à son père, et revient en France en 1901 et 1909. Ce rapprochement diplomatique donne lieu à des fêtes somptueuses qui mettent la Russie à la mode. Le public occidental découvre avec fascination un continent entier qui demeure encore un pays lointain, exotique, entre Grand Nord et Orient.
Lors des grandes expositions universelles, des concerts de musique ont déjà fait connaître au public le répertoire de la musique russe. Tchaïkovski est connu dès les années 1870-1880, et Rimski-Korsakov dirige à Paris des concerts où sont entendues les œuvres du groupe des Cinq. Cette musique, au langage emprunt des parfums venus d’ailleurs, plait aux compositeurs occidentaux qui s’en inspirent. Des œuvres comme les Danses polovtsiennes extraites du Prince Igor de Borodine et Shéhérazade de Rimski-Korsakov sont connues du public bien avant l’arrivée des Ballets russes.
Le groupe des Cinq : ce groupe de musiciens russes romantiques se fit connaître à l’époque de l’abolition du servage par Alexandre II en 1861. Autour de leur fondateur Mili Balakirev, les compositeurs du groupe veulent créer une musique nationale russe et optent pour les genres les plus expressifs : l’opéra, le ballet et la musique symphonique. Ils délaissent néanmoins la musique de chambre et le concerto, à qui Tchaïkovski donnera leur lettres de noblesse russes.
Serge Diaghilev (1872-1929) est le véritable fondateur de la compagnie des Ballets russes pour lesquels il organise chaque année des tournées en Europe, de 1909 à sa mort. Il choisit avec soin les œuvres musicales qu’il veut montrer au public occidental désireux d’exotisme. Il commence d’abord par une exposition rétrospective d’art russe, au Grand Palais, en 1906, puis poursuit en 1907 au Palais Garnier par cinq grands concerts historiques russes. En 1908, il présente l’opéra Boris Godounov de Moussorgski, avant de se tourner, l’année suivante, vers la représentation de ballets sur des musiques russes. C’est en 1909 au théâtre du Châtelet, que la troupe d’artistes qu’il a constitué sous le nom de Ballets russes se produit pour la première fois, avec un immense succès, avant de parcourir l’Europe ou le continent américain, chaque année jusqu’en 1929.
Diaghilev réunit pour ses ballets une équipe d’artistes russes talentueux, tant pour la chorégraphie (comme les danseurs Mikhail Fokine et Vaclav Nijinski) que pour les décors et les costumes (comme les peintres et décorateurs Léon Bakst et Alexandre Benois). L’équipe des Ballets russes offre ainsi à chaque représentation un véritable chef-d’œuvre mêlant la danse, la musique et le décor.
Les Danses polovtsiennes de Borodine, L’Oiseau de feu de Stravinski et Shéhérazade de Rimski-Korsakov comptent ainsi parmi les œuvres les plus applaudies par le public français, et à ce titre les plus représentées par la compagnie des Ballets russes.
Diaghilev réserve les audaces au public parisien alors moins conservateur. Ce n’est que plus tardivement qu’il donne à Londres ou à Berlin certaines œuvres de Stravinski. Le Sacre du printemps, composé par Stravinski pour Diaghilev et créé en 1913 dans le tout nouveau théâtre des Champs-Élysées, demeure l’œuvre emblématique des Ballets russes et de la modernité en ce début du XXe siècle. Après une première série de représentations sur des musiques russes, Diaghilev décide rapidement de passer commande à des artistes non russes et fait appel à de nombreux compositeurs de son temps tels Satie (Parade, 1917 ; Jack in the Box, 1926), Ravel (Daphnis et Chloé, 1912), Debussy (Prélude à l’après-midi d’un faune, 1912 ; Jeux, 1913), Poulenc (Les Biches, 1924) ou encore à des peintres comme Picasso, Matisse, Chirico, Miro…
La mode
Après la chute de l’Empire, Paris garde toujours sa réputation de capitale de la mode et son « sens du chic à la Parisienne ». La mode connait des évolutions stylistiques qui vont de pair avec le développement de la bourgeoisie, qui joue un rôle majeur dans la révolution industrielle. Les styles se libèrent et se propagent dans les nouveaux espaces de sociabilité que sont les salons.
L’évolution des normes sociales à la Belle Époque, notamment en ce qui concerne le rôle des femmes dans la société, a par ailleurs impacté la mode : les vêtements sont devenus moins restrictifs et plus fonctionnels, permettant aux femmes une plus grande liberté de mouvement.
Le costume masculin
Contrairement à la mode féminine, le costume masculin évolue beaucoup plus lentement… Il est rigide et sobre pour permettre de mettre en valeur les vêtements haut en couleur des femmes. L’homme dandy porte le complet trois pièces, pantalon, veste et gilet noir ou sombre, avec une chemise blanche, une cravate et un chapeau haut-de-forme ou melon selon l’événement. Et quelques accessoires comme la canne à pommeau sculpté, la chaînette d’or et les gants de chevreau.
La mode féminine
Une dame de bonne famille possède une garde-robe pour toute une journée : chaque heure a sa robe. A travers cette époque, la mode et la silhouette féminines vont beaucoup évoluer, se transformer : la taille, les manches, les jupes, …
Dans les années 1889-1892, la tournure (rembourrage porté sous la robe ou la jupe), qui donnait du volume, disparaît pour être remplacée par un petit coussin au niveau des reins créant un petit rebondi. Les drapés se simplifient et marquent de plus en plus la taille.
Dans les années 1893-1897, c’est la mode de la silhouette en sablier : on y voit d’imposantes manches gigot, une jupe conique et une taille toujours marquée, un col montant. Le tissu utilisé est du velours ciselé.
La période 1898-1904 est marquée par l’apparition de l’Art nouveau, qui s’appuie sur les lignes sinueuses des courbes. Ce style, d’abord architectural, s’étend à la mode : on retrouve une silhouette féminine sinueuse avec un corset rigide qui impose une forte cambrure, propulsant le buste en avant et le bassin en arrière. Le corps a une forme de S. Les couleurs vont vers une tendance pastel et les motifs sont floraux.
Par ailleurs, les femmes vont s’inspirer du costume masculin pour donner naissance au tailleur-jupe : une veste de tailleur, longue jupe et un corsage.
C’est dans ces années 1905-1910 que le style « à la garconne » fait son entrée. La toilette va avoir tendance à se simplifier : les jupes perdent leur volant, la taille devient moins marquée et remonte vers la poitrine, les vestes sont plus larges et s’allongent. La silhouette en S va disparaître pour devenir une silhouette droite : on s’inspire de l’Antiquité.
Enfin, dans les 5 dernières années de la Belle époque, on trouve une influence des ballets russes et une émergence du style « sultane » avec une touche orientalisante. Les couleurs sont plus vives et les robes sont en « tonneau » de la taille jusqu’aux chevilles. Pour le soir, ces dames portaient un turban sur la tête.
Le corset fait partie du costume du XIXème siècle. C’est une pièce qui modèle le corps et la silhouette de la femme et qui était porté pour chaque occasion.
L’impact des personnalités influentes comme la célèbre actrice Sarah Bernhardt ou la Marquise de Païva, fut considérable. Ces figures, par leur statut et leur visibilité, ont introduit de nouveaux standards de beauté et de sophistication. Leur influence ne se limitait pas seulement à leur cercle social immédiat : leurs choix vestimentaires étaient imités par les femmes de toute la société.
Les événements sociaux majeurs de l’époque ont également joué un rôle important. Par exemple, l’Exposition Universelle de 1900 à Paris a été un catalyseur pour la mode, présentant des styles internationaux et innovants. Cet événement a mis en lumière des tendances telles que l’élégance des silhouettes éthérées et l’utilisation audacieuse de matières comme la soie et le velours.
De nouvelles tenues féminines sont conçues pour le sport. L’anglaise Elisabeth Smith Miller invente au milieu du 19èsiècle les culottes bouffantes : popularisées par Amélia Bloomer, elles porteront le nom de bloomers. Considérées comme inconvenantes, elles trouveront leur usage dans les 1890-1900 avec la pratique de la bicyclette.
Pour les bains de mer, les tenues consistent pour les femmes en une robe mi-longue, avec corset, manches longues, pantalon et charlotte sur la tête ; les tenues sont en laine, et de préférence de couleur sombre, bien que certaines coquettes osent le blanc. Pour les hommes, une combinaison une pièce à manches courtes et pantalon à mi-mollets.
Annette Kellermann, jeune femme nageuse australienne, est à l’origine du maillot qui commence alors, vers 1913, à rétrécir et devenir proche du une pièce.
En savoir plus sur l’histoire des maillots de bain à la Belle Époque : https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/petite-histoire-des-maillots-de-bains-de-1850-1928
La gastronomie
La Belle Époque, qui évoque l’élégance et les festivités voit la naissance de la cuisine moderne mise au point par Auguste Escoffier, l’homme qui amène la France au sommet de la gastronomie mondiale.
Les motifs végétaux et ondulants naturels de l’art nouveau se retrouvent non seulement dans l’architecture et les arts décoratifs, dans la peinture, la joaillerie, le mobilier mais aussi dans l’art de la table.
En ce début du XXe siècle, Paris s’impose plus que jamais comme la capitale de la gastronomie. La cuisine bourgeoise se propage partout, même dans les menus des tables les plus aristocratiques. La cuisine devient savante avec ses plats mijotés, ses recettes complexes, des sauces riches à base de crème ou de beurre…
Les repas reflétaient cette époque du luxe et du faste, de la convivialité et du plaisir gustatif avec des menus particulièrement abondants (près de 10 plats), selon un protocole et des règles de composition rigoureuses.
On y dégustait des hors d’œuvre destinés à stimuler l’appétit, des potages ou consommés (bisque d’écrevisse, consommé d’œufs pochés…), des œufs (il existait près de 200 préparations d’œufs et 50 recettes d’omelette), le plat de poisson (sole meunière, raie au beurre noir,…), les préparations de viande accompagnées de légumes (selle de veau poêlée avec des carottes nouvelles, bœuf braisé,…), le buffet froid (composé de terrines, viandes en gelée, foie gras), les rôtis (servis au dîner), les salades pour faciliter la digestion, les légumes variés (choux de Bruxelles, choux fleurs, haricots verts…), le dessert pour conclure le repas avec une variété d’entremets chauds et froids (soufflés, beignets de fruits, charlottes, crêpes Suzette, poire Belle-Hélène, fraises Sarah Bernhardt, blanc-manger, …) avant de terminer le repas par un café accompagné de mignardises et parfois de digestifs.
Quant aux boissons, le champagne était le breuvage prisé des élites, gentlemen et des dames élégantes de la Belle Époque.
L’accord des vins et des mets est une chose d’importance et ne doit pas non plus être négligé. Ainsi les règles sommelières entrent en scène avec des blancs préférés pour les poissons et plutôt des rouges tanniques pour accompagner les viandes.
L’eau n’est servie que pour l’accompagnement de la salade.
L’absinthe, aussi connue sous le nom de « Fée Verte » voit son apogée de 1880 à 1910. Initialement appréciée par l’élite bourgeoise, cette liqueur forte, distillée à 70°, a rapidement charmé le monde des arts. De l’écriture à la peinture impressionniste, elle a fasciné un cercle vaste et varié d’adeptes. Toutefois, frappée d’accusations d’induire la folie, l’absinthe fut finalement proscrite en 1915. Pendant la Belle Époque, la France entame une fervente campagne contre l’usage de l’alcool, ciblant notamment l’absinthe, tandis que, dans un contraste saisissant, le vin et, à plus forte raison, le champagne, sont consacrés symboles nationaux, représentatifs d’une griserie sophistiquée.
Auguste Escoffier (1846 – 1935)
Escoffier, personnalité emblématique de la gastronomie à la Belle Époque, conçoit de nombreux et fameux plats et desserts qui participent à l’expansion de la renommée de la cuisine française dans le monde.
La collaboration entre Auguste Escoffier et César Ritz, le pionnier de l’hôtellerie de luxe, est une des alliances les plus emblématiques et influentes de l’histoire de la gastronomie et de l’hospitalité. Ils redéfinissent l’expérience du luxe dans les hôtels et la restauration à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, et posent les fondations de l’hôtellerie moderne. César Ritz, directeur du Grand Hôtel à Monte Carlo, propose en 1884 à Auguste Escoffier de prendre la direction des cuisines cet Hôtel en hiver et celles du Grand National à Lucerne en été. Ils décident de s’associer pour ouvrir l’Hôtel Savoy à Londres en 1889. César Ritz en a pris la direction, Escoffier est chargé des cuisines. Le succès est fulgurant : ils attirent l’élite de l’époque, de la royauté européenne aux célébrités et magnats de l’industrie. Ils innovent en introduisant des menus imprimés, des dîners à plusieurs plats servis à des tables individuelles (plutôt qu’au buffet), et une attention méticuleuse portée à la sélection des ingrédients. Après le Savoy, Escoffier prend en charge de la direction des cuisines du Ritz à Paris et du Carlton à Londres.
Escoffier est honoré en 1919 par la distinction la plus prestigieuse de France, celle de chevalier de la Légion d’Honneur. Les plats et desserts de Auguste Escoffier sont devenus des incontournables de la gastronomie française. Il développe le concept de brigade de cuisine, et rédige de nombreux ouvrages.
L’histoire de la Crêpe Suzette :
La crêpe Suzette doit son nom à la célèbre sociétaire de l’Académie-Française, Suzanne Reichenberg, qui fait construire à Saint-Raphaël la célèbre Villa Reichenberg (aujourd’hui Villa Marie), par l’architecte Pierre Aublé en 1883.
L’histoire raconte que, en 1890, au Grand Café de Monte Carlo, le Prince de Galles (futur Edouard VII d’Angleterre) attendait en compagnie de Suzanne Reichenberg, que l’apprenti-pâtissier d’Auguste Escoffier lui confectionne sur un réchaud à alcool, ses crêpes quotidiennes. Probablement impressionné par le regard du prince, le jeune pâtissier (16 ans) renversa de la fine de champagne sur les crêpes qui s’enflammèrent aussitôt. Sans perdre son sang-froid, le garçon étouffa les flammes sous une pluie de sucre et déclara au prince qu’il s’agissait d’une nouvelle recette baptisée « Prince de Galles ». Ce dernier, galant et modeste aurait alors répondu : « Je n’en suis pas digne, nous donnerons plutôt à cette chose exquise le nom de cette jeune personne qui est avec moi ». Le doux prénom de Suzette fut retenu pour cette gourmandise.
L’histoire de la Madeline de Proust :
La « madeleine de Proust » tire son origine du célèbre roman de Marcel Proust (1871-1922) : Du côté de chez Swan, premier tome de A la recherche du temps perdu. Au début du roman, la mère de l’auteur lui sert un thé pour le réchauffer et une madeleine. En trempant sa madeleine dans le thé, Proust replonge avec émotion dans ses souvenirs d’enfance. Il remonte à une époque ancienne où vivant à Cambray, sa tant Léonine lui faisait goûter une madeleine trempée dans son infusion. C’est la madeleine de Proust !
Marcel Proust fut un homme exigeant quant aux plats que sa gouvernante lui préparait. Il s’inspirera de chacun de ses domestiques qu’il appréciait, pour faire naître leur existence, telle Françoise, personnage mythique de son œuvre À la recherche du temps perdu : la cuisinière de la famille. Françoise savait choisir les produits du marché établissait les repas comme un véritable cordon-bleu, et grande chef-cuisinière dans son domaine à Illiers, chez la tante Léonie du petit narrateur.
Plus tard, à Paris, Marcel Proust, devenu fin gourmet, privilégiait certains mets comme la sole cuisinée au Ritz, une salade russe de chez Larue, un rouget de chez Prunier. Ces restaurants étaient parmi les plus en vogue en 1900 à Paris, et fréquentés par les aristocrates et la haute bourgeoisie, très critiques et influentes dans l’univers de la fine gastronomie française.
La madeleine se présente sous la forme d’une « coquille Saint-Jacques », telle que Proust l’avait imaginée :« …elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés petites madeleines qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d’une coquille Saint-Jacques… ».
Les arts visuels
Les arts visuels à la Belle Époque
La production artistique connaît une abondance sans précédent à la Belle Époque, qui fait de Paris la capitale des arts. Bien que la capitale accueille de nombreux peintres engagés dans la voie d’un art moderne, la peinture officielle, académique, mise en avant par l’Académie des Beaux-Arts contrôle encore les principaux salons. Le Prix de Rome et ses représentants monopolisent les commandes publiques, à l’image de Jean Paul Laurens ou Carolus Duran. Les peintres d’avant-garde dépendent quant à eux de collectionneurs et de marchands d’art comme Léo Stein, Ambroise Vollard ou Victor Chocquet et voient leurs œuvres exposées dans de rares salons artistiques comme celui des Indépendants ou des Artistes Français créés en 1884, ou encore le Salon d’Automne créé en 1903.
Lors de l’exposition universelle de 1900, les Impressionnistes triomphent dans une exposition au Grand Palais. Le doyen, Claude Monet, est au sommet de sa gloire dans le Paris de la Belle Époque : il commence sa série des Nymphéasdont plusieurs tableaux sont exposés chez le marchand Paul Durand-Ruel et rencontrent un grand succès.
Les artistes des générations suivantes s’écartent de l’impressionnisme et subissent l’influence d’autres peintres qui ouvrent de nouvelles voies. Ainsi Paul Gauguin, juxtapose des aplats de couleurs vives et simplifie à l’extrême le tracé pour faire ressortir l’authenticité des scènes. Il inspire de nombreux peintres comme Félix Vallotton, Pierre Bonnard, Maurice Denis, Edouard Vuillard, ou encore Paul Sérusier. Tous se regroupent au début des années 1890 sous le nom de nabis. Paul Cézanne, autre figure majeure de la peinture, intègre des formes géométriques à ses paysages et abandonne la convention du point de vue unique, ce qui fait de lui le précurseur des peintres cubistes.
Pablo Picasso et Georges Braque sont les maitres de ce nouveau mouvement. Les Demoiselles d’Avignon, œuvre qui puise autant dans les nouvelles références artistiques que dans l’art primitif, achevée en 1907, est considérées comme le premier manifeste. L’art de Picasso est un art de rupture, « affranchi de plusieurs siècles d’imitation de la nature ». Il dépasse les audaces des représentants du fauvisme tel Henri Matisse, qui se distingue par l’utilisation de couleurs violentes qui sont « plus expressives que descriptives »
L’art de l’affiche
En 1870, l’affiche publicitaire prend son essor avec le développement des techniques d’impression, et l’apparition de la lithographie en couleur. La demande s’accroit grâce au développement industriel et commercial, en particulier pour les très grands formats. L’affiche suscite de plus en plus l’engouement du public et remplit le paysage urbain, recouvrant les murs des villes et nourrissant l’imaginaire collectif.
A la Belle Époque, âge d’or de l’affiche, de nombreux artistes tels Choubrac, Pal, inspirés par Jules Chéret, réalisent des milliers d’affiches visibles sur les murs de Paris et ailleurs en France. La production d’affiches s’organise et les premiers collectionneurs voient le jour. L’affiche publicitaire envahit l’Europe où différents styles se développent selon la sensibilité culturelle du pays. Les affiches sont proposées lors d’expositions notamment lors des Expositions Universelles à la fin du Siècle.
Fils d’un typographe, Jules Chéret réalise sa première affiche en 1858 pour l’opérette Orphée aux enfers d’Offenbach. Celle-ci connaît un véritable succès. En 1896, il ouvre son propre atelier de lithographie dans lequel il met au point l’imprimerie trichromique en utilisant seulement 2 pierres et quadrichromique sur 3 pierres. Il peint ses sujets dans un style romantique, avec des couleurs vives (rouge, bleu et jaune) en utilisant le blanc du papier de manière ingénieuse. Ses affiches les plus célèbres montrent d’élégantes et séduisantes jeunes femmes (les Chérettes) qui font la promotion de nombreux produits tels que des voitures ou encore des expositions, des représentations au Moulin Rouge et aux soirées du « Bal de l’Opéra » ou au « Palais de Glaces ». Chéret, auquel on attribue le titre de « Père de l’affiche » a créé et imprimé plus de 1000 affiches et a été le premier professionnel de la publicité.
À la fin du XIXe siècle, la passion du public pour l’affiche est à son apogée. Dans toute l’Europe, de nombreux collectionneurs s’arrachent les affiches de tous formats et réclament des éditions spéciales ou des exemplaires supplémentaires. Pour répondre à cet engouement, Jules Chéret fonde l’édition « Les Maîtres de l’Affiche » en 1896. Il choisit des affiches célèbres et les imprime en lithographie, sur un papier épais de 29 x 40 cm environ.
Cette publication en petit format, facile à collectionner, permet aux amateurs d’admirer et d’acquérir les plus belles œuvres graphiques européennes et américaines.
Toulouse-Lautrec dessine sa première affiche pour le Moulin Rouge en 1892 : « La Goulue », une danseuse de French cancan. L’œuvre est très admirée par le public parisien, notamment par Jules Chéret. Avec cette première affiche, Toulouse-Lautrec casse la plupart des règles esthétiques existantes. Il révolutionne la structure, la composition ainsi que l’utilisation de la typographie en répétant « Moulin Rouge » trois fois sur la base d’un seul « M ». La silhouette de Valentin « le désossé » (le contorsionniste), suggère quant à elle, une lanterne magique et les débuts du cinéma. Ses trente affiches, totalement avant-gardistes et immédiatement reconnaissables, constituent une référence absolue pour les graphistes du monde entier.
A la fin du siècle, de nombreux symbolistes tels que Georges de Feure, Gustav Adolf Mossa, James Ensor, Pierre Puvis de Chavannes, Arnold Böcklin ou Félicien Rops créent de magnifiques affiches pour leurs expositions au « Salon des Cent ». C’est l’époque du Moulin Rouge, de la montée de Montmartre, d’Aristide Bruant et du « Cabaret du Chat Noir ».
Les « Nabis », Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Henri Gabriel Ibels, Félix Vallotton ont également réalisé quelques chefs-d’œuvre. Ces affiches ont fait la transition avec l’Art Nouveau.
Incarnation de la Belle Époque, l’Art Nouveau influence tous les Arts décoratifs, de l’illustration, de l’architecture en passant par l’affiche, le papier peint, la verrerie et les bijoux. Tirant leur inspiration de la nature et de la féminité, les artistes de ce mouvement ont créé des motifs de formes arrondies, avec une profusion de détails, d’ornementations, d’allégories et de symboles. L’Art Nouveau embrasse tout ce qui occupe l’espace disponible dans une explosion d’ornementation autour du sujet central, généralement une femme. Le portefeuille « Documents décoratifs » créé en 1902 par Alphonse Mucha, présente 72 planches qui déclinent toutes les possibilités de cet art. Cette œuvre est considérée comme le manifeste de ce mouvement.
Alphonse Mucha est le maître incontesté de l’Art Nouveau. Ses affiches idéalisées représentant des femmes opulentes avec une longue chevelure, sont généralement entourées de fleurs, d’allégories et de motifs symboliques. L’image monumentale est souvent cernée de plusieurs cadres décorés par des motifs dorés.
Sa première affiche pour Sarah Bernhardt dans le rôle de Gismonda lui assure en 1894 un succès immédiat. Jusqu’en 1905, il créé des centaines de lithographies et de somptueuses affiches avec l’aide de l’imprimeur Champenois à Paris. Cette imprimerie est alors au sommet de son Art et maîtrise parfaitement l’impression difficile en or.
Leonetto Capiello, le « Père de la publicité moderne », construit sa renommée au début du 20ème siècle, en plein boom des affiches publicitaires. Il élève l’affiche de la rue au niveau des Beaux-Arts. Il collabore à la revue « Frou-Frou », pour laquelle il crée la première affiche en 1901. En 1903, il conçoit son affiche pour le Chocolat Klaus : Sur fond noir, une femme vêtue de vert chevauche un cheval rouge. La marque « Chocolat Klaus » est inscrite en grandes lettres jaune vif. L’impact de cette affiche est immédiat et les clients demandent les chocolats « avec le cheval rouge ».
C’est le début de la publicité moderne !
En transgressant les traditions artistiques de la Belle Époque, Cappiello libère l’affiche de ses contraintes et annonce l’arrivée d’une toute nouvelle direction qui transformera l’Art graphique du 20e siècle.
Sa méthode est basée sur la surprise visuelle ; l’image de l’affiche saute aux yeux et attire facilement l’attention des passants. Il isole des personnages, des animaux, des clowns ou des visages, contrastés sur un fond foncé, souvent noir. La marque est inscrite en grand, avec une typographie très lisible et une couleur qui contraste avec le reste de l’image.
De 1901 à 1939, Cappiello produit près de 550 affiches pour des sociétés françaises, italiennes, espagnoles, portugaises ou suisses, qui deviendront mythiques dans l’histoire de l’affiche. Cappiello souvent surnommé « le père de la publicité moderne » est le maître incontesté du début du 20e siècle et l’un des plus importants créateurs d’affiches au monde. Son style unique, l’un des principaux d’Europe, inspirera de nombreux artistes jusque dans les années 1940.
Le Cinéma à la Belle Époque
L’industrie du cinéma a été fondée pendant la Belle Époque. Les premiers pionniers sont Louis Lumière, Georges Méliès, Charles Pathé et Léon Gaumont. Le 28 décembre1895, au salon indien du Grand Café, 14 boulevard des Capucines à Paris, a eu lieu la première vue payante des images prises par le cinématographe deLouis Lumière (1864-1948). C’était La Sortie des usines Lumière. Au printemps et pendant l’été de cette année, Lumière a tourné de nombreux petits films, qui font son succès : L’arroseur arrosé, Partie d’écarté, Arrivée d’un train à la Ciotat, Barque sortant du port, et Repas de bébé par exemple. Chaque film ne durait qu’une minute, représentant des petites scènes de la vie quotidienne d’un bourgeois. L’intérêt de Louis Lumière n’était pas pour les films eux-mêmes, mais plutôt pour la vente du cinématographe. Il tournait ses films essentiellement dans le but de faire la publicité de son appareil. Mais malgré lui, Louis Lumière a créé l’idée de la séance payante pour le cinéma. Louis Lumière quitte le Grand Café et s’installe dans une salle à lui. A la fin du siècle, il avait 1424 petits films à son actif.
Georges Méliès (1861-1938) travaillait comme illusionniste au théâtre Robert Houdin. Dès 1896, il commence à mettre en film des spectacles de théâtre dont le plus connu est Escamotage d’une dame chez Robert Houdin. Comme Louis Lumière, Georges Méliès tournait beaucoup de petits films, mais créait souvent des spectacles fantastiques pour ses films au lieu de montrer des scènes réalistes tels Lumière du jour et Méliès de la nuit . Malheureusement, Méliès n’ayant pas le temps de distribuer ses films lui-même, dépendait des autres et ses films ont été exploités par des compagnies étrangères.
En 1908, Charles Pathé (1863-1957), contrôlait un tiers du marché global pour les films. Il s’intéressait à l’aspect de production et du commerce. Le tournage des films a été réalisé par une succession de metteurs en scènes. Le premier était Ferdinand Zecca (1864-1947), qui débute comme acteur. Léon Gaumont (1864-1946), lui aussi, travaillait sur l’aspect économique du cinéma en laissant sa secrétaire, Alice Guy (1875-1968) diriger les films. Elle fut la première femme metteur en scène au monde. De 1897 à 1906 Alice Guy aura tourné 301 films !
L’aspect artistique n’était pas encore très important pour les films de cette époque. Zecca ou Guy n’avaient que peu de connaissances en théâtre ou en aspects artistiques quand ils sont devenus metteurs en scène. Le cinéma n’était pas important sur le plan artistique, mais plutôt sur le plan économique. Le tournage des films ne devait pas coûter cher, et les metteurs en scènes devaient travailler rapidement. Un ou deux films étaient tournés par semaine. Le but le plus important était de profiter de la vente des films.
Au début du vingtième siècle, l’histoire des films devient de plus en plus importante. Sous la mise en scène de Zecca est produite une première version de Quo Vadis (1901), puis des drames de la vie quotidienne comme Les victimes de l’alcoolisme (1902) et Passion (1902/03). Les classiques de la littérature sont adaptés en films. Albert Capellani (1870-1931), qui travaillait pour Pathé, était un des metteurs en scène les plus connus pour ce type de film avec. L’Assommoir (1909) et Germinal (1913) adoptés des romans de Zola, Notre Dame de Paris (1911) et Les Misérables (1912) de Hugo. Les Misérables fut le plus long film de l’époque, avec une durée de trois heures et demie.
La comédie et le burlesque apparaissent durant ces années. L’acteur Max Linder (1883-1925) était connu pour son personnage comique dans une série de films chez Pathé : il joue son premier rôle dans un film de Zecca, La vie de Polichinelle (1905). André Heuzé fut le premier metteur en scène à se spécialiser dans le film comique, en créant des films absurdes de poursuite. Avec Victorin Jasset (1862-1913) commencent les films policiers, basés sur les feuilletons dans les journaux populaires. Émile Cohl, en 1908 réalise le premier dessin animé, Fantasmagorie.
Peu de temps plus tard, Louis Feuillade (1874-1925) devient metteur en scène chez Gaumont. Il tourne d’abord des drames réalistes de la vie quotidienne dans la série La vie telle qu’elle est (1911-13). Mais le grand succès vient avec son film en plusieurs parties sur le bandit gentleman Fantômas (1913/14). Il répéta ce succès plus tard avec des séries comme Les vampires (1915) et Judex (1916/17).
La première guerre mondiale a interrompu la production des films en France.
La littérature
La littérature à la Belle Époque
La production littéraire de la Belle Époque est très abondante et éclectique. Les poètes parnassiens, avec le slogan de l’art pour l’art, sont très appréciés de l’élite bourgeoise qui lit notamment les œuvres de Leconte de Lisle (mort en 1894), José-Maria de Heredia, Sully Prudhomme et François Coppée, président d’honneur de la Ligue de la patrie française et antidreyfusard notoire.
Maurice Barrès est l’un des chefs de file du courant anti-moderne, qui regroupe des auteurs comme Henry Bordeaux, René Bazin ou Paul Bourget. Pierre Loti, auteur à succès qui aborde le XXè siècle en nostalgique d’un passé révolu, rejette la modernité́ pour se tourner vers un Orient consolateur. À l’inverse, d’autres écrivains exaltent les valeurs de la modernité́ et de la technique, comme Octave Mirbeau, qui publie en 1907 le premier récit de voyage en automobile, ou Filippo Tommaso Marinetti, dont le Manifeste du futurisme est publié́ dans Le Figaro en 1909.
La littérature anarchiste invite elle aussi à la rupture et au rejet de l’ordre, de l’autorité́ et des principes de la bourgeoisie. Des revues anarchistes sont créées, dont la plus célèbre, L’Assiette au beurre, accueille les textes de nombreuses plumes célèbres, comme Anatole France. Auteur engagé en faveur de nombreuses causes sociales et politiques, libre-penseur, anticlérical, il fait figure d’autorité auprès des socialistes et devient alors « un écrivain officiel de la gauche ». Dans le même temps, des poètes comme Blaise Cendrars, Paul Fort ou Guillaume Apollinaire expérimentent de nouvelles formes et jettent les bases de la poésie moderne.
Le naturalisme, dont Émile Zola s’affirme comme le chef de file, compte notamment Stendhal, Balzac, Flaubert ou encore Edmond et Jules de Goncourt. Le mouvement pousse à l’extrême les critères retenus par les écrivains réalistes, en s’appuyant encore davantage sur les théories et les pratiques scientifiques. Ainsi, il emprunte aux travaux sur l’hérédité de Claude Bernard l’idée que l’être humain est déterminé par ses origines, non plus seulement sociales, mais d’abord physiologiques. L’écrivain s’attache donc à dépeindre tout ce qui relève des corps, d’où le scandale que provoquent alors les œuvres rattachées à ce courant, jugées trop vulgaires.
A travers ses personnage, Zola explore les questions sociales, économiques et psychologiques, du Second Empire à la Troisième République. Son œuvre la plus célèbre est la saga des Rougon-Macquart regroupant un ensemble de 20 romans, écrits entre 1870 et 1893. L’un des plus emblématiques de cette série est La Bête Humaine, roman noir, fusion d’un écrit sur la justice et d’un autre sur le monde ferroviaire. Publié en 1883, Au Bonheur des Dames, onzième volume des Rougon-Macquart, entraine le lecteur dans l’univers des grands magasins parisiens, apparus sous le Second Empire. Son engagement dans l’affaire Dreyfus marque un tournant dans sa vie. En 1898, Zola publie son célèbre article « J’accuse », lettre ouverte au président de la République, Félix Faure. Il y dénonce l’injustice et la corruption au sein de l’armée française.
En 1909 est lancée La Nouvelle Revue française : elle regroupe des écrivains partageant « une même exigence, celle d’une littérature pure, indifférente aux goûts du public, refusant tout alignement politique ». Encore inconnu du grand public à cette époque, André Gide en est un des écrivains majeurs, mais la NRF publie aussi bien des auteurs établis que des écrivains prometteurs, parmi lesquels Paul Valéry, Alain-Fournier, Charles Vildrac, Léon-Paul Fargue, Paul Fort, Roger Martin du Gard ou encore Jules Renard.
L’essor de la presse écrite
La Belle Époque constitue le véritable âge d’or de la presse écrite, dans un contexte d’alphabétisation croissante de la population qui entraîne alors une forte demande. D’une part, l’essor de la presse écrite est encouragé́ par la loi du 29 juillet 1881 qui instaure la liberté́ de la presse. D’autre part, une série d’innovations techniques permettent d’importants gains de production, comme l’utilisation de la linotype, une machine de composition au plomb qui se développe en Europe dans les années 1890, le perfectionnement de la presse rotative ou le remplacement progressif des machines à vapeur par l’électricité́. En même temps que les journaux s’étoffent, ils deviennent plus attrayants grâce aux nouveaux procédés d’illustration comme la photographie ou l’héliogravure, qui permet l’impression en couleurs. Dans le même temps, l’extension du réseau ferré rompt l’isolement de certaines régions et permet la diffusion des principaux titres de la presse écrite sur l’ensemble du territoire.
Avant 1914, la presse française diffuse chaque jour près de 12 millions de journaux. Le Petit Parisien, dont les ventes passent de 770 000 exemplaires en 1899 à près de 1,5 million en 1913, devient le premier quotidien national pendant cette période. Dirigé par Jean Dupuy, il possède sa propre imprimerie, comme la plupart des grands journaux, mais aussi sa propre papeterie, ce qui lui permet de maîtriser l’ensemble du processus de fabrication. Leader à la fin du XIXème siècle, Le Petit Journal voit ses ventes décliner, en raison notamment de ses prises de position antidreyfusardes. Malgré son affaiblissement, il tire encore à 900 000 exemplaires avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, et se place avec Le Petit Parisien, Le Journal et Le Matin, comme l’un des quatre grands quotidiens nationaux de cette période. Aux côtés de ces titres populaires figure une certaine presse d’élite. L’Écho de Paris, dont le tirage atteint 135 000 exemplaires en 1912, est apprécié du lectorat catholique et conservateur, tandis que Le Temps, un journal républicain modéré́ d’influence protestante, est largement répandu dans l’élite de centre gauche.
La Belle Époque voit également l’essor de la presse militante et engagée, comme L’Intransigeant d’Henri Rochefort. Dans le camp royaliste, Le Gaulois, est considéré comme le journal de la noblesse et de la haute-bourgeoisie, tandis que L’Action française, fondée en 1908, affiche ouvertement son opposition acharnée à la Troisième République et à la démocratie. La Croix en reste le premier quotidien, de la presse catholique avec un tirage quotidien qui atteint 170 000 exemplaires vers 1900. La presse de gauche voit la naissance de plusieurs titres-phares comme L’Aurore, créé par Ernest Vaughan et célèbre pour avoir publié l’article J’accuse… ! d’Émile Zola en janvier 1898, ou L’Humanité, fondé en 1904 par Jean Jaurès. En 1897, le premier quotidien féministe, La Fronde, naît sous l’impulsion de Marguerite Durand.
Le néologisme « intellectuel » apparait dans le contexte de l’affaire Dreyfus. Georges Clemenceau est le premier à utiliser ce substantif dans les colonnes de L’Aurore en janvier 1898 pour désigner les hommes de lettres et de sciences qui s’engagent pour défendre le capitaine dégradé. Le contenu politique n’est pas la seule caractéristique des journaux de l’époque : les journaux affichent également leurs préoccupations littéraires et artistiques. Arthur Meyer, fondateur du Gaulois, affirme que « le principal souci d’un lanceur de journal était de publier un roman sensationnel »
La presse destinée aux enfants connaît elle aussi un premier âge d’or : aux côtés de références comme le Magasin d’éducation et de récréation et Le Petit Français illustré, présents depuis la seconde moitié du XIXe siècle, de nouveaux titres apparaissent, comme Les Belles Images et L’Épatant, qui rencontrent un certain succès, grâce aux nombreuses illustrations qu’ils proposent aux lecteurs.
Renouveau de l’édition et la création des prix littéraires
La scolarisation de masse et l’essor de la presse écrite, ont favorisé une certaine démocratisation de la lecture dont la production littéraire de la Belle Époque a pu profiter.
L’édition scolaire représente un marché considérable pour l’industrie du livre, et les principales maisons de ce secteur comme Hachette, Larousse, Belin, Armand Colin, Delagrave, Hatier ou Nathan en tirent parti.
Le monde de l’édition dans son ensemble connaît cependant un léger déclin, à cause de la concurrence des journaux qui « tiennent le lecteur en haleine avec leurs feuilletons », au point que certains éditeurs choisissent de publier des journaux de lecture, comme Flammarion avec Le Bon Journal ou Hachette avec Lectures pour tous. Malgré le ralentissement de l’activité éditoriale, certains genres comme les ouvrages de vulgarisation, les livres pratiques ou les romans populaires connaissent un certain succès. C’est la naissance des collections à bas prix mais à grands tirages, dans lesquelles paraissent des romans policiers comme la série des Arsène Lupin ou des Fantômas, mais également des romans historiques comme Les Pardaillan de Michel Zévaco.
La Belle Époque est aussi celle de la création des premiers prix littéraires : le prix Goncourt est décerné́ pour la première fois en 1903, le prix Femina l’année suivante.
La démocratisation de la lecture touche aussi les revues : la Revue des Deux Mondes, fondée en 1829, compte environ 40 000 abonnés pendant cette période, un chiffre jamais atteint par aucune autre revue intellectuelle. Des revues littéraires apparaissent comme le Mercure de France, La Revue blanche, et surtout La Nouvelle Revue française, qui deviendra une référence dans l’entre-deux-guerres sous l’impulsion de Gaston Gallimard.
Les salons littéraires
Sous le Second Empire et la Belle Époque, les salons accueillent le Tout-Paris littéraire et politique.
Sous Napoléon III et la Belle Époque, perdure la tradition du salon littéraire parisien entériné par la marquise de Rambouillet. De nombreuses femmes de la haute société accueillent chez elles, selon des jours, des heures et des spécialités. Le Salon de la Princesse Mathilde est, sous le Second Empire, ce lieu de rencontres littéraire le plus en vue. En effet, il est l’antichambre de l’Académie. La princesse reçoit les peintres et les gens de lettres le mercredi. Le dimanche, elle organise un grand bal. Elle aide les jeunes talents comme Flaubert et compte toujours sur le soutien des frères Goncourt.
Madame de Saint-Marceau, férue de musique, accueille surtout les musiciens tels Fauré ou Debussy. Elle y reçoit aussi Isadora Duncan qui danse lorsque Ravel se met au piano, en présence de Dumas Fils, Willy et Colette ou Gabriele d’Annunzio, dont le livre l’Enfant de volupté traduit en français, a fait fureur dans la vie littéraire parisienne. Il est rejoint par Marcel Proust, Boni de Castellane, Léon Daudet ou Robert de Montesquiou. Ce dernier, à la fois caustique et méchant, mais à l’entregent incontournable, est la coqueluche du Tout-Paris
Au Square de Messine, madame Aubernon reçoit Marcel Proust mais aussi Guy de Maupassant. Ce jeune normand est présenté au Paris littéraire par son ami Flaubert. Parmi ses nouvelles naturalistes, Maupassant en écrira sur la vie parisienne, dévoilant un certain pessimisme naturaliste, mais l’auteur sera toujours distant sur les partis pris politiques ou littéraires. Madame Aubernon accueille aussi madame Cavaillet qui va devenir sa rivale. En effet, cette dernière tient aussi salon, où elle reçoit le couple Curie, Anna de Noailles, ou Anatole France dont elle devient la maîtresse et fera la carrière littéraire à travers ses réceptions pendant plus de 30 ans.
Au 104, rue de Miromesnil, c’est Geneviève Strauss qui tient Salon. L’épouse de Georges Bizet reçoit des musiciens et des écrivains, comme le « Petit Proust ». Ce dernier y rencontre Charles Haas, aristocrate mondain au charme fou. Il deviendra l’amant de Sarah Bernhardt et servira de modèle de Swann pour le jeune auteur. Malheureusement, l’affaire Dreyfus disperse le salon, comme il dispersera aussi celui de la comtesse de Greffulhe. Cette déesse au col de cygne, malheureuse en mariage mais extrêmement riche, reçoit admirablement bien dans son Hôtel de la rue d’Astorg. Ses relations familiales avec le royaume de Belgique lui permettent aussi de donner un caractère international à son salon. Elle introduit avec Misia Sert les Ballets russes, mais aussi Debussy et Moussorgski. Elle encourage Anna de Noailles et impose Degas, Renoir, Manet en Angleterre.
Enfin, rue de Monceau, le salon de Madeleine Lemaire, grande amie de Marcel Proust. Cette salonnière est d’abord peintre et reçoit avec sa fille le gratin cosmopolite de la capitale tels les Broglie, les Haussonville, les Arenberg au milieu desquels évolueront Degas, Manet, Toulouse Lautrec. Elle fera rencontrer Marcel Proust et Reynaldo Hahn qui auront une liaison amoureuse éphémère mais sincère….
Des inventaires sont mis à votre disposition pour comprendre et apprécier la richesse patrimoniale et culturelle de la Belle Époque. Vous pourrez parcourir ces inventaires, avec des descriptions détaillées, des photographies et des informations pour chaque élément répertorié. Chaque ville membre du Réseau Belle Epoque a contribué à cet inventaire. Cette page continuera de grandir et de s’enrichir au fur et à mesure de l’adhésion de nouvelles villes.
N’hésitez pas à contacter notre équipe si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez contribuer à cette précieuse collection de ressources.